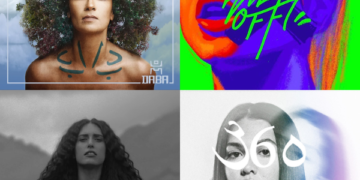Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Le lundi 13 octobre 2025, les 20 otages israéliens détenus par le Hamas ont été relâchés. Au même moment, près de 250 prisonniers palestiniens étaient libérés des prisons israéliennes. Ce jour-là, les médias occidentaux se sont pourtant focalisés presque exclusivement sur les victimes du premier camp, en occultant celles, bien plus nombreuses, du second. Peut-on expliquer ce biais à la lumière de la thèse que vous développez dans votre dernier ouvrage, La civilisation judéo-chrétienne. Anatomie d’une imposture*, où vous montrez comment cette notion, apparue dans les années 1980, a fait d’Israël un bastion avancé de l’Occident au cœur de l’Orient ?
Depuis la riposte israélienne au massacre du 7 octobre, il est évident que la presse mainstream occidentale a érigé le « deux poids, deux mesures » en règle absolue. Concernant les prisonniers palestiniens, on oublie souvent que chacun d’eux a un nom, une famille, une histoire, une douleur. Au moment de l’annonce du cessez-le-feu, même des journaux respectables comme Le Monde ont consacré une page entière à la joie des familles d’otages israéliens. Rien, en revanche, sur la joie des familles palestiniennes de Gaza dont les proches venaient d’être libérés. Ce déséquilibre perdure : le traitement différencié de l’information est incontestable — et profondément regrettable.
Pour revenir à l’expression de « civilisation judéo-chrétienne », il faut rappeler que les idéologues du sionisme — ce nationalisme juif apparu à la fin du XIXᵉ siècle — étaient des intellectuels européens de confession juive, à commencer par le premier d’entre eux, Theodor Herzl, auteur de L’État des Juifs. Journaliste viennois, juif mais totalement laïque, Herzl n'hésitait pas à qualifier l'entreprise sioniste de coloniale et écrivait qu'un Etat juif serait « un avant-poste de la civilisation opposée à la barbarie ».
Ce fil conducteur n’a jamais cessé d’être brandi. Lorsque, dans les années 1980, l’expression « civilisation judéo-chrétienne » s’est imposée dans le langage courant — même si ses racines savantes sont bien plus anciennes — elle a contribué à rapatrier le judaïsme en Occident, en effaçant sa dimension orientale. Ce glissement idéologique a renforcé la croyance selon laquelle l’État d’Israël serait la pointe avancée de l’Occident en Orient.
Or, par un effet de proximité, bien connu des journalistes, les Israéliens sont désormais perçus comme des Occidentaux, tandis que les Arabes — et les Palestiniens en particulier — restent vus comme des étrangers « douteux », « hostiles » ou « menaçants ». Les premiers suscitent l’empathie médiatique, les seconds la méfiance. Et pourtant, pendant des siècles, le Juif a incarné en Europe l’étranger par excellence, l’archétype de l’Oriental : il représentait la figure même de l’altérité. C’est cette représentation qui a nourri l’antisémitisme et conduit jusqu’à l’extermination de six millions de Juifs par le nazisme.
En Israël même aujourd'hui, les Juifs d’origine orientale, bien qu’ayant été longtemps discriminés, ont fini par adopter le langage et les codes idéologiques de la classe dominante — celle d’origine européenne. L’histoire, on le sait, produit souvent ce type de renversement. Et pour le comprendre, on peut revenir à Marx, écrivant à propos du prolétariat que les classes dominées adoptent et intériorisent l’idéologie de la classe dominante.
Aujourd’hui, la majorité des Israéliens se considèrent comme des Occidentaux. Et les Occidentaux, en retour, les traitent comme tels.
La « juivarabe » que vous êtes, pense-telle qu’une paix soit un jour possible et durable entre les arabes et les juifs de Palestine ?
Non pas en tant que juivarabe mais en tant qu’historienne plutôt, je dirais que vient un moment où les guerres se terminent. Celle-ci — qui est devenue une sorte de guerre de Cent Ans — s’achèvera aussi, d’une manière que je ne connais pas, mais qui prendra la forme d’une paix. J’ai simplement peur, vu mon âge, de ne pas voir ce moment.
Il faut ici tenir compte de deux facteurs essentiels. Les Palestiniens ont montré — y compris à l'occasion de cette tragédie à dimension génocidaire qu'a représenté la guerre menée par Israël à Gaza — qu’ils ne veulent pas, ou ne veulent plus, abandonner leur terre. Ils préfèrent mourir plutôt que partir. Ils ont intériorisé la leçon de la Nakba : ils ont quitté leur terre une fois, et en ont été chassés à tout jamais. Ils ne sont pas prêts à vivre une seconde Nakba [fait référence à l'expulsion et à l'exode en 1948 d'une grande partie de la population arabe de Palestine].
Aujourd’hui, Palestiniens et Israéliens sont à peu près à égalité démographique, avec un peu plus de six millions de chaque côté. Peut-être que quelques dizaines de milliers de Juifs quitteront ce qui est aujourd'hui Israël, mais la majorité restera. Est-ce injuste ? Certainement. Mais l'existence de cet Etat ne sera pas le premier fait accompli créé par l’histoire. Et un jour ou l’autre, je ne sais pas quand, ce fait accompli sera réparé d'une manière ou d'une autre. Quelle forme politique prendra cette paix ? Je l’ignore. Je ne crois plus à la solution à deux États — ou alors elle ne pourrait émerger qu’à la suite d’une guerre civile en Israël, car les colons ne partiront pas d’eux-mêmes, et ils sont aujourd’hui près de 800 000 entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Y aurait-il un Etat binational, une fédération ou une confédération ? Mon souhait, ce serait qu’un jour, il y ait un seul État, du fleuve à la mer, où tous les habitants — dans leur diversité culturelle et religieuse — jouiraient d’une égalité totale, sans suprématie des uns sur les autres.
En mai 2025, ONU Femmes estimait qu’une femme ou une fille était tuée chaque heure à Gaza. En novembre dernier, l’ONU et l’UNICEF affirmaient que près de 70 % des victimes de la guerre étaient des femmes et des enfants. Malgré les valeurs morales supposées de sororité, comment certaines féministes occidentales parviennent-elles à justifier ou à relativiser ce massacre ?
Évidemment, plus un conflit fait de victimes civiles, plus ce sont les femmes et les enfants qui en paient le prix. En Ukraine, c’est différent : il s’agit d’une guerre classique, armée contre armée, et ce sont surtout des hommes qui meurent. En revanche, la guerre menée par Israël à Gaza est une guerre contre les civil.e.s gazaoui.e.s.
Beaucoup de féministes occidentales sont, avant tout, occidentales — avant d’être féministes. J’ai été profondément déçue par certaines d’entre elles, pour lesquelles j’avais la plus grande estime, et qui se sont tues, ont relativisé les faits ou se sont compromises dans des prises de position moralement et politiquement contestables sur cette guerre.
Le mieux qu’elles aient su dire, c’est : « Israël va trop loin. ». J'ai eu envie de leur demander : à partir de combien de milliers de morts considère-t-on qu’on va « trop loin » ? Cinquante mille ? Soixante mille ?
Beaucoup de féministes occidentales sont, avant tout, occidentales — avant d’être féministes. J’ai été profondément déçue par certaines d’entre elles, pour lesquelles j’avais la plus grande estime, et qui se sont tues, ont relativisé les faits ou se sont compromises dans des prises de position moralement et politiquement contestables sur cette guerre.
Vous avez suivi la naissance du mouvement féministe autonome tunisien à la fin des années 1970, qui a donné lieu à la création de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et de l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD). Que retenez-vous de cette période de votre engagement pour les droits des femmes ? Et pourquoi avoir choisi de militer dans le mouvement tunisien plutôt que dans un féminisme occidental ?
En réalité, je me suis toujours engagée dans les mouvements militants tunisiens. Lorsque je suis arrivée à Paris pour poursuivre mes études universitaires, la première chose que j’ai faite a été de m’inscrire à la cellule des étudiants du Parti communiste tunisien — que j’ai quitté quelques années plus tard.
J’ai bien sûr suivi les luttes féministes en France, mais je n’étais pas présente à une période importante de leur déroulement : entre 1973 et 1975, je vivais au Cameroun. J’ai vu naître le mouvement féministe tunisien, lorsque les premières militantes se réunissaient encore au Club Tahar Haddad. Puis, lorsque l’Association tunisienne des femmes démocrates a été légalisée en 1989, j’y ai adhéré. Je crois même que c’est la seule carte d’organisation que j’aie jamais gardée depuis que j’ai quitté le Parti communiste !
Votre engagement auprès des féministes tunisiennes est-il aussi né de discriminations que vous auriez subies, dans votre jeunesse, en Tunisie ?
Personnellement, je n’ai jamais souffert de discriminations dans ma famille. Mes parents étaient ouverts, progressistes. Mais on baignait tous, sans pouvoir y échapper, dans une atmosphère misogyne — y compris au sein des familles juives, même si elles s'étaient globalement plus modernisées que les musulmanes sur ce plan-là. Je me souviens d’une anecdote : mes grands-parents avaient trois enfants, et chacun d’eux n’a eu que des filles. On plaignait sincèrement mon grand-père, notable respecté, patriarche malheureux, privé de petits-fils. Un véritable drame ! Quand ma sœur est née, la dernière de la fratrie, les employés de mon grand-père ne sont même pas montés féliciter les parents. L’un d’eux s’est contenté de dire : « Ça ne fait rien ! ». Finalement, mon oncle et ma tante ont eu un garçon, et tout le monde a poussé un soupir de soulagement : l’héritier mâle était enfin là.
En grandissant, j’ai vu combien les discriminations étaient omniprésentes dans la société tunisienne de ma génération. Elles crevaient littéralement les yeux, à chaque coin de rue. On pouvait ne pas en être victime directement, mais on ne pouvait pas ne pas les voir.
Dans l’introduction de votre ouvrage « Les Valeureuses. Cinq Tunisiennes dans l’Histoire », Editions Elyzad, 2017,vous écriviez : « depuis des temps immémoriaux, la Tunisie accueille ou enfante des femmes libres. Cette soif féminine de liberté, cette insurrection contre les normes et les dogmes n’est pas une denrée d’importation… ». Comment expliquez-vous cette spécificité tunisienne ?
En général, dans les milieux traditionnels, les mères ne conservent leur statut social que si elles reproduisent l’idéologie dominante, si elles s'en font les instruments les plus efficaces. Combien de jeunes filles, en Tunisie, m’ont dit : « Ma mère ne voulait pas que j’aille à l’école, c’est mon père qui l’a forcée à accepter. »
Mais si l’on observe l’histoire de tous les pays du monde, on fait le même constat que celui que j’ai établi pour la Tunisie : partout, il y a eu des figures de femmes extraordinaires. Il y a toujours eu des insurrections de femmes, individuelles et parfois collectives. Même si certaines, contraintes et forcées, ont accepté leur sort, et même si, dans leur majorité, les femmes ont été les instruments de la domination masculine — dans la mesure où le rapport de force leur était totalement défavorable —, leurs luttes ont bel et bien existé. On ne les voit pas toujours parce qu’elles empruntent d’autres formes, d’autres méthodes. L’arme des femmes, souvent, c’est la ruse — une arme qui s’est d’ailleurs transformée, au fil du temps, en stigmate.
Si l’on observe l’histoire de tous les pays du monde, on fait le même constat que celui que j’ai établi pour la Tunisie : partout, il y a eu des figures de femmes extraordinaires. Il y a toujours eu des insurrections de femmes, individuelles et parfois collectives.
Dans le monde arabe, à l’issue des révoltes et révolutions démocratiques de 2011, des mouvements féministes ont vu le jour, ils rejettent notamment l’instrumentalisation des femmes par les régimes autocratiques. Mais ces féministes peuvent-elles survivre alors qu’elles évoluent au sein de gouvernements non démocratiques ?
Je crois que l’Association tunisienne des femmes démocrates a été un bon exemple : il y a eu au début des années 90, au moment du durcissement du régime de Ben Ali, une controverse au sein de l’association : fallait-il s’en tenir à nos revendications féministes exclusivement sans s’occuper de politique au sens étroit du terme ou fallait-il entrer dans le champ politique et à la fois défendre le féminisme et lutter pour la démocratie ? C’est la deuxième option qui a été retenue. De grandes figures du féminisme tunisien comme Khadija Cherif, Bochra Belhaj Hamida, Sana Ben Achour, entre autres, ont dit que dans la mesure où les droits des femmes ne peuvent être pleinement conquis qu’au sein de régimes démocratiques, nous devons nous engager à la fois pour les droits des femmes et pour l’avènement de la démocratie. Je pense aussi que les féministes doivent se battre sur ces deux fronts. Il a été heureux que la deuxième option ait été adoptée parce qu’elle a permis à l’ATFD d'acquérir ses lettres de noblesse et sa légitimité dans la société tunisienne. En 2011, au moment de la révolution, on a réalisé que l’ATFD avait été de toutes les batailles contre la dictature. Par la suite, les féministes tunisiennes ont remporté d'incontestables victoires : la parité des listes électorales, l’adoption de la Loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et quelques autres.
Y compris dans le monde arabe, l’horizon du féminisme s’est aujourd’hui agrandi, métissé et intersectionnalisé. Cela l’affaiblit-il ou, au contraire, lui donne-t-il plus de force, de diversité et de visibilité ?
L’intersectionnalité, inventée par les féministes noires américaines, est un concept très utile, auquel j’adhère pleinement. Ces militantes ont rappelé que les conditions d’existence d’une bourgeoise blanche et celles d’une prolétaire noire ne sont pas comparables : le féminisme doit donc intégrer plusieurs paramètres — la classe, la race, l’origine sociale. En Tunisie, par exemple, si les féministes ignoraient les luttes des ouvrières agricoles, traitées comme du bétail, elles passeraient à côté d’une dimension essentielle de leur combat.
Je soutiens aussi sans réserve la cause des LGBTQ+. Cependant, je ne suis pas certaine que l’ATFD doive s’en charger directement ; il peut en revanche exister des convergences et des collaborations entre associations.
Mais l’intersectionnalité, aujourd’hui, est parfois dévoyée. Elle a été parasitée par la profonde crise identitaire qui traverse le monde. Certaines féministes, enfermées dans une logique de repli, finissent par oublier la lutte commune. Or, quelles que soient les différences entre elles, les femmes continuent de subir des discriminations.
Le mouvement Me Too, souvent qualifié de révolution, a touché tous les pays de la Méditerranée en libérant la parole des femmes contre les violences sexuelles. Il a ouvert un nouveau front : celui de la « bataille de l’intime ». Comment faire pour qu’elles en sortent victorieuses ?
Ce sera un long combat, surtout chez nous, sur la rive sud ! Je veux sur ce plan rendre hommage à Monia Ben Jemia, la première femme en Tunisie à avoir parlé de l’inceste dans son essai Les Siestes du Grand-Père [Cérès Éditions, 2021]. Tout le monde sait à quel point ce fléau est répandu, mais le silence demeure total. Dans nos sociétés, l’intime est tabou : on n’en parle pas, c’est honteux. Traditionnellement, même le mot épouse était évité ; pour désigner sa femme, on disait dari – « ma maison ».
Les premières féministes tunisiennes ont mené la bataille du droit, une étape indispensable. Puis elles se sont attaquées aux violences, obtenant une loi organique – hélas restée lettre morte faute de décrets d’application. Un seul progrès est tangible : le violeur n’est plus innocenté s'il épouse sa victime. En revanche, le viol conjugal n’a pas été reconnu : la sphère de l’intime demeure inviolée. La question de fond est là : à qui appartient le corps des femmes ? Dans nos sociétés, beaucoup continuent de penser qu’il appartient à la famille. La virginité devient alors un capital social et familial. Et même en Occident, où la « bataille de l’intime » se mène publiquement, notamment à travers Me Too, elle est loin d’être gagnée.