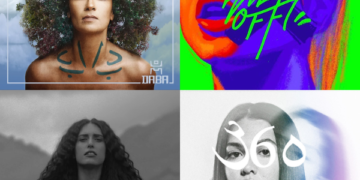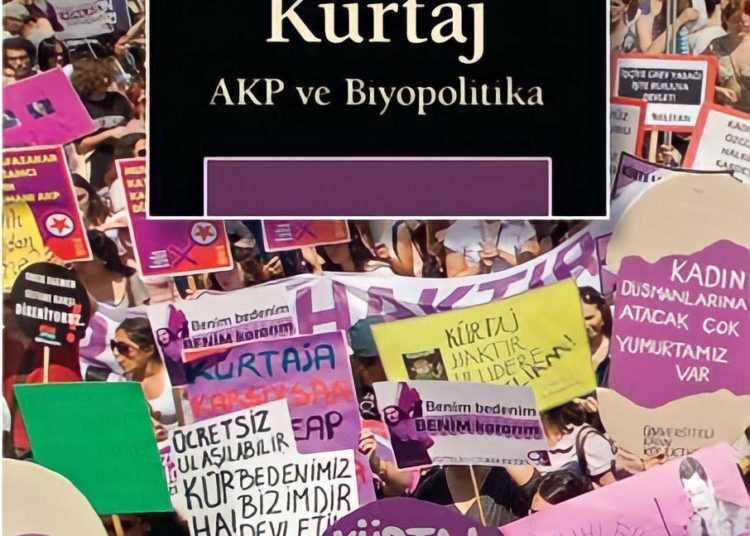Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe) VO
Bien que le droit à l'avortement soit légalement garanti en Turquie, les femmes se heurtent à de nombreux obstacles dans la pratique. Si les Turques peinent déjà à accéder à ce droit, la situation est encore plus critique pour les réfugiées syriennes, qui subissent des désavantages cumulatifs.
En vertu de la loi n° 2827 relative à la planification familiale, promulguée en 1983, la contraception est légale en Turquie et l’avortement est autorisé jusqu’à dix semaines de grossesse. Ce délai peut être prolongé dans des cas exceptionnels où la vie de la femme ou celle du fœtus est en danger. Pourtant, dans tout le pays, les hôpitaux, publics comme privés, refusent très fréquemment de pratiquer l’IVG, invoquant divers prétextes.
Obligée de se préparer à une naissance non désirée
« J’ai 25 ans et j’ai été témoin de la guerre en Syrie. J’en porte encore les stigmates, partage Fatima E., une réfugiée syrienne enceinte. Je ne suis pas prête à accoucher. »
Fatima porte encore les séquelles psychologiques de la guerre et ne souhaite pas devenir mère avant la fin de son traitement médical. Mais son mari et sa famille s'immiscent dans ses décisions et contrôlent une grande partie de sa vie. Malgré elle, elle est tombée enceinte.
Au début, elle a tenté de cacher sa grossesse, mais elle a découvert que les hôpitaux publics ne pratiquaient pas d'avortements après dix semaines. Les médecins lui ont dit que l'intervention était « interdite ». Les hôpitaux privés lui ont affirmé pouvoir la pratiquer, mais à un prix exorbitant. Fatima se prépare désormais à un accouchement non désiré.
Des barrières dans les hôpitaux publics et privés
Pour cerner l'ampleur du problème, nous avons contacté des hôpitaux publics et privés à Şanlıurfa et Diyarbakır, deux provinces du sud-est de la Turquie. Tous les hôpitaux des deux provinces ont déclaré ne pas pratiquer d'avortements.
Diyarbakir compte 11 hôpitaux publics capables de pratiquer des avortements sûrs et gratuits (un en centre-ville et dix dans les districts environnants), ainsi que neuf hôpitaux privés. Şanlıurfa compte 21 hôpitaux, dont 14 publics et sept privés. Pourtant, les établissements publics comme privés nous ont indiqué que « l’avortement est interdit ».
Certains hôpitaux de Diyarbakir que nous avons contactés par téléphone nous ont suggéré de venir consulter sur place. Dans les deux provinces, quelques cliniques privées pratiquent des avortements uniquement si la grossesse met en danger la vie de la femme et avec le consentement de son mari, moyennant un coût compris entre 35 000 et 55 000 livres turques (entre environ 700 et 1100 euros). Elles refusent catégoriquement de pratiquer des avortements en cas de grossesse hors mariage.
Dans les hôpitaux privés, l'attitude des propriétaires et des administrateurs détermine souvent si les médecins sont autorisés à pratiquer des avortements. Cette attitude est fortement influencée par la politique gouvernementale, ce qui restreint davantage l'accès des femmes aux soins.
Double désavantage pour les femmes réfugiées syriennes
Si l'accès à l'avortement est déjà difficile pour les femmes turques, les femmes réfugiées syriennes sont confrontées à des obstacles encore plus importants en raison du manque d'information, de la stigmatisation sociale et de la précarité financière.
En mai 2025, la Turquie accueillait 1 335 312 Syriens, dont 21 188 à Diyarbakir et 238 475 à Şanlıurfa. Les témoignages des femmes que nous avons interrogées dans ces deux villes révèlent les traumatismes et les risques mortels auxquels sont confrontées celles qui se voient refuser un droit fondamental.
Si l'accès à l'avortement est déjà difficile pour les femmes turques, les femmes réfugiées syriennes sont confrontées à des obstacles encore plus importants en raison du manque d'information, de la stigmatisation sociale et de la précarité financière.
« Le médecin a essayé de me convaincre d’accoucher »
Fatima Elhasu, 33 ans, a fui la ville de Raqqa au centre de la Syrie il y a 14 ans et s'est installée à Şanlıurfa, où elle a épousé un membre de sa famille. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte de son cinquième enfant, elle l'était de huit semaines, soit encore dans le délai légal des dix semaines pour l'avortement.
« Je voulais interrompre ma grossesse car nous n'avions pas les moyens d'avoir un autre enfant, confie-t-elle. Mais ni les hôpitaux publics ni les hôpitaux privés n'ont accepté de pratiquer l'avortement. Le médecin m'a dit : "Allah pourvoira à tous les besoins de votre enfant", et a ajouté qu'interrompre la grossesse était un péché. »
Fatima a accouché en 2024 et a maintenant cinq enfants. Son mari et elle ne souhaitent pas d'autres enfants, mais ils n'ont pas les moyens de se procurer la pilule contraceptive, qu'elle juge « trop chère ».
Besoin de l'accord du mari
Makhouz, 40 ans, également originaire de Raqqa, vit elle aussi à Şanlıurfa. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle n'a pas pu l'annoncer à son mari. Elle souhaitait avorter car elle était prisonnière d'un mariage malheureux, mais ayant grandi dans une famille très religieuse, elle savait qu'en Syrie, l'avortement est considéré comme un meurtre de sang-froid.
« Pour moi, toute relation sexuelle non désirée est un viol, déclare-t-elle. Je ne voulais pas d'enfant, mais à l'hôpital, on m'a dit que j'avais besoin de l'accord de mon mari. Comme je ne pouvais pas lui dire que je voulais avorter, j'ai dû accoucher. »
Amira Husein, 35 ans, est arrivée à Diyarbakir en provenance de Qamishli après avoir perdu son mari pendant la guerre. Elle s'est remariée par la suite et s'est installée dans le district de Bismil. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enceinte, il était déjà trop tard pour avorter.
« La pilule contraceptive est trop chère, je ne pouvais donc pas l'utiliser régulièrement, justifie-t-elle. Les hommes refusent d'utiliser une quelconque protection, et nous, les femmes, n'avons pas les moyens de nous procurer la pilule à cause de difficultés financières. »
La gynécologue Dr Sabire Aygün explique qu'en Turquie, l'avortement est socialement divisé en deux catégories : au sein du mariage et hors mariage.
« Les femmes qui souhaitent avorter hors mariage se heurtent aux normes sociales, à la peur de la stigmatisation et au manque de soutien de leur partenaire, affirme-t-elle. Même au sein du mariage, l'avortement n'est pas accessible dans tous les hôpitaux. Les médecins et les administrateurs refusent souvent de le pratiquer. »
Selon Dr Aygün, les femmes syriennes, souvent peu informées de leurs droits, sont particulièrement vulnérables, surtout celles vivant en zone rurale. « Elles ne connaissent pas le fonctionnement du système de santé et n'ont pas accès à une information fiable, explique-t-elle. La plupart n'ont pas les moyens de se faire soigner dans des cliniques privées, ce qui explique le taux de grossesses non désirées plus élevé chez les Syriennes que chez les Turques. »
Un avortement clandestin peut être mortel
Dr Aygün avertit que de nombreuses femmes qui n'ont pas accès aux services d'avortement se tournent vers des cliniques clandestines.
« Les conditions dans les cliniques clandestines sont extrêmement dangereuses. S'y rendre augmente le risque d'infection, pouvant entraîner la mort », alerte-t-elle, soulignant que les femmes non mariées rencontrent encore plus de difficultés pour accéder à des avortements sécurisés, car les hôpitaux publics refusent souvent de pratiquer des avortements hors mariage. Bien que cela ne soit pas inscrit dans la loi, c'est une réalité. « Ni les médecins ni les administrateurs ne veulent assumer leurs responsabilités, ce qui pousse les femmes à recourir à des procédures dangereuses », déplore-t-elle.
« Les conditions qui règnent dans les cliniques clandestines sont extrêmement dangereuses. S'y rendre augmente le risque d’infection, pouvant entraîner la mort. »
Le recours à des médicaments dangereux
Helin Güneş, pharmacienne à Diyarbakir, explique que les femmes viennent souvent en pharmacie chercher des médicaments qui provoquent les menstruations.
« Si le médicament n'est pas prescrit par un médecin, nous leur demandons pourquoi elles en ont besoin, explique-t-elle. En discutant avec elles, nous comprenons qu'elles veulent l'utiliser pour interrompre leur grossesse. Ces médicaments ne peuvent être prescrits que par des médecins généralistes, pourtant certaines femmes trompent les médecins pour se les procurer. »
« Nous les avertissons que ces médicaments peuvent provoquer des hémorragies graves, voire mortelles, poursuit-elle. Nous leur conseillons de consulter un médecin, mais certains trouvent encore le moyen de se procurer ces pilules sans ordonnance. »
Güneş confirme également que le prix élevé de la pilule contraceptive contribue aux grossesses non désirées : « La pilule contraceptive est chère et les femmes n'ont pas les moyens de se la procurer. C'est pourquoi les grossesses non désirées sont fréquentes. »
Note : Pour des raisons de sécurité, les noms des réfugiées kurdes et arabes syriennes ont été modifiés. Dans les deux villes, il a été impossible d'obtenir des données sur le nombre de femmes ayant subi un avortement dans les hôpitaux privés, ces derniers ayant refusé de communiquer ces informations.
Cet article a été réalisé grâce au soutien du Bureau de Tunis de la Fondation Rosa Luxembourg.