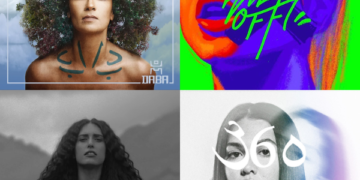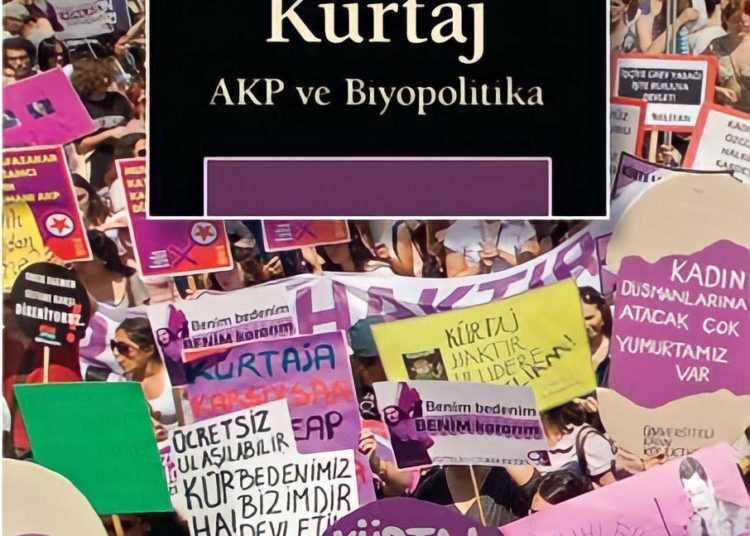Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Photo principale de la disparue Rahma Zaqout – Crédit : Doaa Shaheen
Doaa Shaheen
Dans une petite tente plantée au milieu d’un camp de déplacés à l’ouest de Gaza-ville, Abir, la quarantaine marquée par l’angoisse, serre entre ses mains une vieille photographie. L’image, fanée, montre une femme au visage doux, aux traits fatigués mais sereins : Rahma Zaqout, sa belle-mère, cette grand-mère aimante, pilier de toute une famille, dont on n’a plus eu aucune nouvelle depuis plus de neuf mois.
Depuis le 6 novembre 2024, le silence s’est installé. Ce jour-là, Rahma avait pris la douloureuse décision de fuir Beit Lahia, au nord de Gaza, sous un rideau de feu et de bombes. Comme des milliers d’autres familles, elle avait été contrainte de fuir son foyer, espérant trouver un refuge — en vain.
Sortir, sans jamais retourner
»Ma belle-mère était atteinte de maladies chroniques, mais face aux bombardements, nous n’avions pas d’autre choix », raconte Abir d’une voix lasse. « Elle s’est appuyée sur son mari, affaibli lui aussi, et sur sa fille Mervat pour marcher, lentement, péniblement, vers l’ouest de la ville. Elle avançait à petits pas, le regard embué de larmes. Je me souviens encore de ses yeux pleins d’inquiétude et de son visage tendu par la peur. «
Avant son départ, Rahma a pris le temps d’embrasser chacun de ses petits-enfants, glissant à sa belle-fille quelques mots qu’elle n’oubliera jamais : « Prenez soin de vous, je vous enverrai un message dès que je trouverai un endroit sûr. »
Mais ce message ne viendra jamais. Depuis ce jour, aucun signe de vie, aucune trace. Seul un silence écrasant et une pluie de questions sans réponse ont pris sa place.
« Nous avons d’abord cru qu’elle ne parvenait pas à nous contacter à cause de l’interruption du réseau, explique Abir. Nous avons essayé de l’appeler encore et encore, sans succès. Nous avons contacté la Croix-Rouge, puis la Défense civile, mais personne ne savait rien. Son nom ne figurait ni dans les hôpitaux, ni dans les listes des martyrs, ni dans les registres d’inhumation. »
Avec les vagues successives de bombardements, la destruction de dizaines de milliers de maisons et les déplacements massifs, les femmes disparues sont devenues une vision tristement familière dans le paysage de Gaza. À la douleur de la guerre s’ajoute celle de l’effacement sans explication, sans trace, sans procédure.
Pour Abir, la peine la plus lourde se lit dans les regards de ses enfants, les petits-enfants de Rahma, qui continuent de l’attendre. « Chaque jour, ils me demandent : Où est mamie ? » Soixante-dix petits-enfants, issus de ses dix enfants, attendent encore que leur grand-mère revienne s’asseoir avec eux, leur prépare du thé, leur raconte les histoires d’autrefois, et murmure ses prières pour eux à la nuit tombée.

Lors de son dernier échange avec la Défense civile, il y a quelques mois, Abir a appris que plusieurs corps en état de décomposition avancée avaient été découverts près d’une zone de déplacement. Mais faute d’accès aux tests ADN, leur identification reste impossible. « Aucun indice fiable. Rien de sûr. Juste l’attente... une attente interminable, et la douleur qui l’accompagne », confie-t-elle.
D’après les données du ministère de la Santé de Gaza et du Centre palestinien pour les personnes disparues et victimes de disparition forcée, les femmes représenteraient environ 453 cas de disparition sur quelque 4500 signalements officiels — soit environ 10 % du total. Un chiffre alarmant, qui témoigne du vide béant dans la documentation des pertes humaines.
Les femmes disparues sont devenues une vision tristement familière dans le paysage de Gaza. À la douleur de la guerre s’ajoute celle de l’effacement sans explication, sans trace, sans procédure.
Pour Ghazi Al-Majdalawi, directeur du Centre palestinien pour les personnes disparues et victimes de disparition forcée, le centre, créé en février 2025, est né d’une urgence vitale : tenter de répondre à la question qui hante chaque foyer de Gaza : « Où sont nos fils, nos filles ? «
»Ce centre a été fondé pour traiter les cas dont on ignore tout, explique-t-il. L’État, les institutions, personne ne fournit de réponses concrètes. Nous comblons un vide avec les moyens du bord. «
L’histoire de Marwa : quand la voix s’éteint
Rahma n’est malheureusement pas un cas isolé. Le 8 juillet dernier, toute communication a été rompue avec Marwa Mosallem, journaliste de 29 ans. Depuis, ses proches vivent dans l’angoisse.
« Je ne partirai pas avec les déplacés... Je ne peux pas laisser mes frères seuls. » Ce sont les dernières paroles que Marwa a adressées à son amie Farah Depuis cet appel, plus rien…
Ce jour-là, Marwa, Moataz et Montaser — trois frères et sœur inséparables — se trouvaient dans leur maison du quartier Al-Tuffah, à l’est de Gaza-ville. Un missile a frappé la maison voisine. En une fraction de seconde, le silence. Depuis, aucune trace de Marwa : ni message, ni appel, ni signal de détresse. Le néant.

Consciente des risques, Marwa avait tout de même choisi de rester à Gaza. Elle avait la responsabilité de ses deux frères, depuis que leurs parents étaient partis en Égypte pour se soigner, avant la guerre. Elle avait pris cette décision en pleine conscience, déterminée à ne pas les abandonner.
Son amie proche, Farah Al-Majaida, également âgée de 29 ans, se souvient avec émotion : “Marwa, ce n’était pas seulement une voix derrière le micro de Radio Jeunes. C’était aussi une créatrice de mode, une combattante d’un autre genre. Elle écrivait ses chroniques avec le cœur, et portait la guerre dans sa chair ».
« Je ne partirai pas avec les déplacés... Je ne peux pas laisser mes frères seuls. » Ce sont les dernières paroles que Marwa a adressées à son amie Farah Depuis cet appel, plus rien…
Elle ajoute : « Nous avons vécu ensemble la peur, le manque, les explosions. Notre dernière conversation remonte à peu de temps avant l’attaque. Je n’arrive toujours pas à croire qu’on ignore tout de son sort. »
Depuis, les tentatives de la retrouver se poursuivent, sans relâche. La Croix-Rouge et les équipes de secours affirment que la zone de l’attaque est considérée comme « extrêmement dangereuse » par l’armée israélienne. Toute intervention y est jugée impossible.

« Trois civils, dont une journaliste reconnue, sont portés disparus. Et pourtant, rien ne bouge. Que faut-il de plus pour que le monde réagisse ? Doit-on attendre une image de leurs corps sous les décombres pour leur accorder une existence ? », s’insurge le journaliste Hani Abou Rizq, un ami très proche de Marwa.
Et pourtant, un espoir ténu subsiste. « Cinq jours après les frappes, Marwa aurait tenté d’appeler un membre de sa famille. Mais l’appel a été interrompu par le manque de réseau », raconte Hani. « Est-ce une preuve de vie ? Peut-être. Mais c’est tout ce qu’on a. Dans un monde où même les preuves ont perdu leur voix. »
Nous ne demandons pas l’impossible
Ghazi Al-Majdalawi revient sur le rôle de son centre : « Nous faisons un travail de fond : documentation, recherche, responsabilité. Nous ne faisons pas que compter les absents. Nous traquons les indices, nous tentons de rétablir les faits. C’est un combat humanitaire, un devoir de justice. »
En raison de l’impossibilité d’interventions sur le terrain, le centre a mis en place une plateforme numérique permettant aux familles d’enregistrer les signalements de disparition. Chaque demande est examinée minutieusement, après échange direct avec les proches.
Les principales causes de disparition, précise-t-il, sont les incursions militaires dans les zones résidentielles, les mouvements de fuite, ou les tentatives de retour pour récupérer des biens essentiels. Le centre a aussi relevé plusieurs disparitions à proximité des centres de distribution d’aide humanitaire gérés par l’ONG « Gaza Humanitarian » — soutenue par des institutions américaines et israéliennes — dans les secteurs de Rafah et Netzarim. Une preuve supplémentaire que même les besoins élémentaires peuvent devenir mortels.
Quant aux obstacles : « Nous opérons sous pression constante. Notre siège a été la cible d’un ordre d’évacuation. Les réseaux sont coupés. L’occupant refuse toute coopération avec les organisations de défense des droits. La coordination est quasi impossible. »
Cette incertitude permanente — ne pas savoir si une femme est encore en vie, décédée, ou retenue quelque part — engendre ce qu’on appelle le « deuil suspendu ». Un chagrin inachevé, sans conclusion, sans possibilité de dire adieu.
Et de conclure : « Nous ne réclamons pas l’impossible. Nous voulons simplement que chaque famille sache ce qu’il est advenu de ses proches. Vivants ou non, il faut leur rendre un visage, une vérité. C’est le strict minimum de justice. »
Quand une femme disparaît, c’est tout un monde qui vacille
Pour Rima Karaja, spécialiste en soutien psychosocial à Gaza, la disparition des femmes ne relève pas seulement d’un drame intime. C’est toute une structure familiale et sociale qui s’effondre. « À Gaza, une femme n’est pas qu’une épouse ou une mère. Elle est souvent le centre de gravité du foyer : elle gère la maison, éduque les enfants, maintient un semblant de quotidien, même dans le chaos. Quand elle disparaît, tout vacille. »
Elle insiste : de nombreux enfants ayant perdu leur mère ou leur grand-mère, sans savoir ce qu’il leur est arrivé, souffrent de troubles du sommeil, d’anxiété chronique, de chutes scolaires, et de crises de pleurs répétées.
Sur le plan psychologique, cette incertitude permanente — ne pas savoir si une femme est encore en vie, décédée, ou retenue quelque part — engendre ce qu’on appelle le « deuil suspendu ». Un chagrin inachevé, sans conclusion, sans possibilité de dire adieu. Des blessures invisibles mais tenaces, qui restent ouvertes bien longtemps après la fin des hostilités.