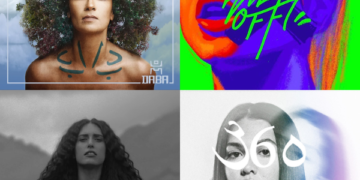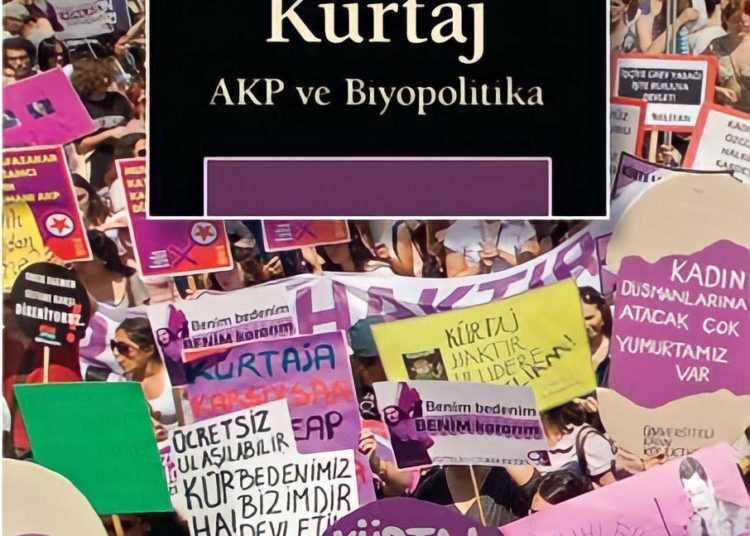Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Elles sont plus de cent mille à détenir la carte d’agricultrice et 7,3% sont à la tête d’exploitations dont la superficie est comprise entre 1 et 5 hectares. Elles représentent près d’un quart des sept millions d’Algériens vivant sur une exploitation. Les statistiques officielles, qui ne prennent pas en compte l’activité informelle des femmes travaillant sur les petites parcelles familiales sans rémunération, évaluent leur présence à 18% sur un million et demi de la population active agricole nationale.
Au Sud comme au Nord, elles ont transmis leur savoir de génération en génération entretenant la terre lorsque les hommes étaient au maquis pour l’indépendance du pays puis émigrés en France ou à l’usine dans les villes. Pourtant la terre a longtemps été associée à l’honneur des hommes, à leur sang. Elle porte le nom de la lignée et ne devait en aucun cas tomber entre les mains des étrangers au clan.
L’ivresse de la reconquête dans le sang de cette terre spoliée par la colonisation française est cependant peu à peu retombée face aux défis de la rentabilité économique. Le système agricole actuel complexe est né des tâtonnements, de reformes et de mesures pour assurer l’indépendance alimentaire et le développement du monde rural. Le domaine privé, 35% de la surface agricole utile, côtoie les exploitations agricoles collectives EAC et les EAI exploitations individuelles octroyées par l’Etat en concession de 40 ans. L’administration accorde les crédits, fournit les semences et commercialise les productions stratégiques dont les céréales. Ce système hybride ne va pas sans la bureaucratie et la corruption qui handicapent les agriculteurs et davantage les agricultrices.
« Posséder la terre est un bonheur, la garder est un combat »
Atika Terriel Saadi, 44 ans, ne le sait que trop bien « posséder la terre est un bonheur, la garder est un combat » dit-elle. Elle est l’une des rares agricultrices à être propriétaire d’une ferme de quarante hectares. Atika a eu la chance de racheter avec son défunt mari la terre de ses grands-parents à Frenda, à quelques deux cents kilomètres d’Oran, capitale de l’Ouest algérien. Pour maintenir à flots son exploitation « un vrai gouffre financier », elle a diversifié son activité : élevage de bovins et de caprins, maraichage et céréaliculture.

Elle rêve d’une agriculture « saine et moderne » et aimerait étendre ses maraîchages en mode biologique sans toutefois demander le label « bio » parce que l’administration algérienne est une machinerie lourde capable de décourager les plus motivés.
« Je n’ai pas de problème avec mes salariés ou mes voisins quand je suis sur mon tracteur ou dans les champs, affirme Atika. Ce sont les dinosaures dans les bureaux qui vous regardent de travers quand ce n’est pas avec lubricité quand vous les sollicitez pour un projet. » Pourtant les femmes persistent dans leurs rêves agricoles.
A l’initiative d’ateliers de formation à la permaculture en Algérie, Faycal Anceur, ancien journaliste, a pu compter parmi ses stagiaires une part importante d’agricultrices et d’universitaires. Elles étaient très intéressées par cette technique et certaines ont même lancé leur propre projet.
Bien entendu, les femmes ne sont pas les seules à subir les lourdeurs bureaucratiques ni les obstacles à l’accès aux crédits bancaires, mais elles sont plus nombreuses à vivre la précarité. « Seuls les gros poissons réussissent à obtenir des financements importants » regrette Atika.
La presse algérienne a effectivement abondamment écrit sur les scandales de milliers d’hectares « concédés » à des proches du pouvoir algérien dont des généraux et des ministres. Si le Code civil algérien leur accorde le même droit que les hommes en matière d’achat et de vente des biens qu’elles ont acquis ou hérité, le Code de la Famille plus inégalitaire prévoit en termes de succession 1/8 pour la veuve avec enfants, 1/6 pour la veuve sans enfants. La part du frère est deux fois plus que celle de la soeur. (Droits fonciers des femmes en Algérie. Par Nadia Ait-Zai)
Bien entendu, les femmes ne sont pas les seules à subir les lourdeurs bureaucratiques ni les obstacles à l’accès aux crédits bancaires, mais elles sont plus nombreuses à vivre la précarité.
Ce code, texte rétrograde s’il en est, se base sur le postulat que la terre ne doit pas passer entre les mains du futur mari des femmes du clan. Longtemps, les soeurs n’osaient pas réclamer leur part pour ne pas affronter leurs frères et provoquer le scandale. Céder son droit permet aussi d’être entretenue par la famille en cas de divorce ou de veuvage. Encore une illusion alimentée par l’ordre patriarcal car dans les faits les femmes travaillent durement pour vivre et peuvent être exclues de leur part d’héritage. Cultiver un potager, élever des volailles et quelques ovins, faire de la poterie, des galettes, tisser tapis et couvertures sont autant de tâches assumées par des générations de mères qui en ont vendu les produits pour nourrir leurs familles.
Atika le sait bien : « j’ai vu toutes ces femmes dans les champs du lever du soleil au coucher. Elles m’ont beaucoup appris du travail de la terre avec peu de moyens ». L’invisibilisation du travail féminin n’a pas disparu en dépit des efforts de quelques associations pour les sortir de leur isolement et leur fournir les informations pour gérer leur patrimoine.
Les difficultés des zones rurales sont démultipliées par les traditions et le poids du patriarcat sur les femmes. L’espace public majoritairement masculin dans les villes est davantage restrictif de la mobilité des femmes dans les villages en raison du manque de transports ou par peur de la mauvaise réputation. En outre, les femmes n’accèdent pas aux formations et à l’information sur les opportunités de financement ou sur les techniques agricoles qu’il faut aller chercher auprès des institutions.
Malgré tout Atika est toujours fière de répondre « je suis fellaha » (agricultrice) quand on lui demande sa profession.