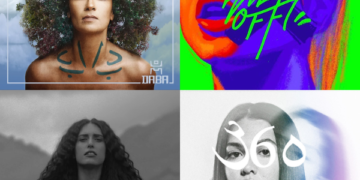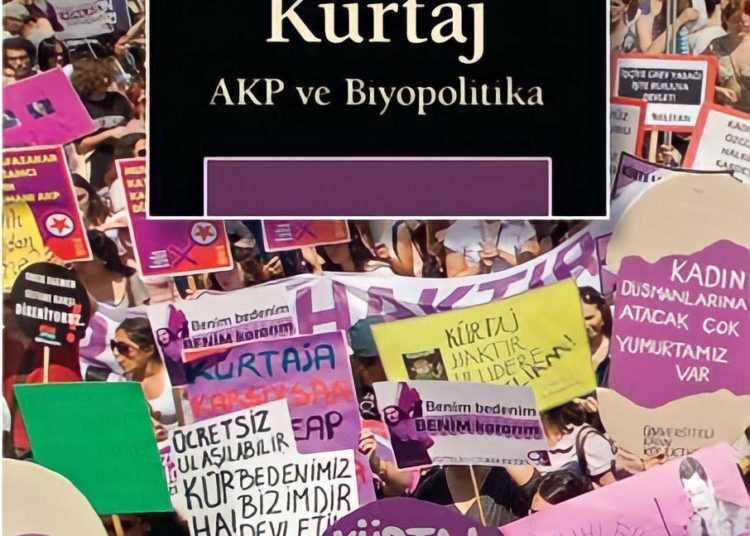Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Le 28 septembre 2020, la militante transféministe Marta Loi a dénoncé sur Facebook avoir trouvé au cimetière Flaminio de Rome une croix sur laquelle étaient gravés son nom et la date de son avortement thérapeutique (ou interruption médicale de grossesse). À côté de la publication de la photo de la petite pierre tombale, elle a écrit « Une image vaut mille mots ». De fait, ce post, qui a été partagé plus de 10 000 fois, a incité de nombreuses femmes à contacter le service des cimetières de la capitale. Ce qu'elles ont découvert était révoltant : des dizaines d'autres fœtus avaient été enterrés là, avec les données sensibles des femmes bien en vue, sans aucun consentement préalable.

« Me retrouver sur un crucifix a été l’ultime étape des tortures qu'une femme doit endurer à Rome lorsqu’elle avorte à des fins thérapeutiques », déclara quelques temps plus tard Francesca Tolino, une des nombreuses patientes à qui personne n'avait demandé à l'hôpital ce qu'elle comptait faire du fœtus, après l'intervention médicale.
Jusqu'alors, on ignorait l'existence de ces « jardins des anges », les aires spécifiques des cimetières réservées à l'inhumation des foetus de plus de cinq mois suite à un avortement thérapeutique. Pourtant, dans ces lieux à l’écart, environ une cinquantaine dans le pays selon le livre-enquête du journaliste Gabriele Barbati (1), entre 500 et 600 inhumations ont lieu chaque année et le plus souvent à l'insu des femmes.
« Ce moment nous a permis de prendre clairement conscience de la grave violation que cette pratique implique à plusieurs niveaux, avant tout en rendant public un événement pourtant intime et privé, en prétendant donner une signification universelle à une expérience que chaque femme vit à sa manière », a commenté Elisa Ercoli, présidente de Differenza Donna, une association qui lutte contre la violence sexiste et qui est à l'origine d'une action collective pour entamer une procédure en justice.
Grâce à cette organisation et à l'impressionnante mobilisation des mouvements féministes, le Garant de la Privacy (le garant de la vie privée) (2) a ouvert une enquête. Suite à cela, en 2023, la mairie de Rome a été condamnée à une amende de 176 000 euros, la société municipale de gestion des déchets à une amende de 239 000 euros et le service sanitaire local (ASL 1) a reçu un avertissement pour avoir violé l'obligation de confidentialité prévue par la législation sur l'avortement. Bien qu'aujourd'hui, soient inscrits sur les tombes de fœtus des codes chiffrés ou des pseudonymes, les inhumations se poursuivent sans obligation de consentement éclairé ni de traçabilité éthiquement acceptable quant aux données sensibles relatives à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
Ombres et lumières de la loi 194
L'avortement en Italie a été dépénalisé par la loi 194 en 1978, qui autorise l'IVG dans un délai de quatre-vingt-dix jours, après un entretien médical. Fruit d'un compromis historique entre les revendications féministes et les partis catholiques conservateurs, le texte a perdu une grande partie de sa portée révolutionnaire initiale et contient, aujourd'hui encore, plusieurs ambiguïtés. À commencer par son titre : « Normes pour la protection sociale de la maternité et sur l'interruption volontaire de grossesse ». Contrairement à d'autres systèmes juridiques, le système italien ne conçoit pas l'avortement comme un droit relevant du libre choix et de l'autodétermination des femmes, mais comme une mesure de santé publique visant avant tout à protéger la vie humaine.
La loi 194 ne fixe pas de délai pour l'avortement thérapeutique, qui n'est autorisé que si la grossesse ou l'accouchement menacent la santé physique ou mentale de la femme enceinte, ou en cas de malformations et de pathologies graves du fœtus. Toutefois, l'article 7 stipule que si le fœtus a atteint un développement lui permettant de survivre en dehors de l'utérus (environ 22 à 24 semaines), le médecin se doit d’agir pour préserver son intégrité physique.
Contrairement à d'autres systèmes juridiques, le système italien ne conçoit pas l'avortement comme un droit relevant du libre choix et de l'autodétermination des femmes, mais comme une mesure de santé publique visant avant tout à protéger la vie humaine.
Le règlement national sur les services funéraires prévoit qu'après la 28e semaine de grossesse, les fœtus soient enregistrés à l'état civil comme mort-nés et soient enterrés d'office. En revanche, pour les avortements pratiqués avant la 20e semaine, la femme dispose de 24 heures pour décider si elle souhaite s'occuper personnellement de l’inhumation (dans ce cas facultative) ou charger l'hôpital de le faire. Le plus souvent, c’est l’hôpital qui traite les fœtus avec les déchets organiques humains, mais il peut aussi déléguer cette tâche à des associations à but non lucratif. Lors de cette procédure, trop rarement expliquée aux patientes, se sont immiscés, au cours des dernières années, des groupes de catholiques traditionalistes qui considèrent l'embryon comme une vie humaine dès la fécondation et l'avortement comme un crime. En l'absence de demande de la part de la femme hospitalisée, ces catholiques intégristes récupèrent le fœtus 24 heures après l’avortement et l'enterrent selon leur rite religieux.

Dieu, patrie et famille
Soutenus par l'Église et le gouvernement Meloni, les groupes « pro-vie », ont mis en place, au fil du temps, des partenariats avec les autorités sanitaires locales et les administrations municipales et régionales. Dans certaines villes, les pro-vie gèrent même les « Jardins des Anges ». L'accord entre l'association bénévole « Difendere la vita con Maria » (Défendre la vie avec Marie) et l'ASL (Agence Sanitaire Locale) de Novare remonte à 1999, lorsque le premier cimetière des « enfants jamais nés » fut édifié dans cette ville du Piémont.
Les organisations « Papa Giovanni XXIII » (Pape JeanXXIII), l'« Armata bianca » (l’Armée blanche), « Difendiamo i nostri figli » (Défendons nos enfants) et l'organisation à but non lucratif « ProVita&Famiglia » (Pro-vie et famille), l'une des promotrices du Congrès mondial des familles de Vérone en 2019, sont également très actives. Durant cette manifestation, la distribution de fœtus en caoutchouc, les prières pour la guérison des personnes homosexuelles, les slogans fascistes en défense de la famille traditionnelle et les campagnes contre l'utilisation du préservatif ont suscité de nombreuses polémiques. Le parrainage de ce congrès par le ministre de la Famille, Lorenzo Fontana, membre de la Lega Nord (La Ligue du Nord), et actuel président de la Chambre des députés, a entraîné de vifs débats, tout comme la participation de Matteo Salvini -à l’époque ministre de l'Intérieur- aujourd'hui vice-président du Conseil des ministres et ministre des Infrastructures et des Transports.
Le lien entre les mouvements anti-avortement italiens et l'extrême droite est d'ailleurs connu depuis longtemps ainsi que le rôle de liaison que ces premiers assument entre les organisations néofascistes et les partis de la Ligue du Nord et de Fratelli d'Italia (Frères d'Italie). Ce sont ces formations politiques qui approuvent dans les conseils municipaux les motions les plus réactionnaires, les plus homophobes et les plus sexistes. En 2024, un amendement proposé par Frères d'Italie a été jusqu’à légaliser la présence des pro-vie dans les hôpitaux et les dispensaires, leur permettant aussi d'accéder aux fonds régionaux, publics et nationaux du PNRR (Plan National de Relance et de Résilience).
Pour les « pro-choix », il s'agit là d'une nouvelle tentative de la présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni visant à fragiliser le droit à l'avortement. En effet, son exécutif ne se contente pas de promouvoir des campagnes en faveur de la natalité, avec des primes pour les familles nombreuses et des aides pour les nouveau-nés, il affaiblit aussi le système de santé national (SSN) au profit du secteur privé, à l’instar des précédents gouvernements au cours des vingt dernières années, quelle que soit leur orientation politique. Ce démantèlement progressif des infrastructures publiques pénalise les dispensaires, soumis à des réductions constantes de leurs fonds et de leur personnel. Selon les statistiques du SSN, 300 centres ont été fermés au cours des dix dernières années, rendant l'accès aux soins de plus en plus difficile pour les habitant.e.s du sud, les couches les plus défavorisées de la population et les migrant.e.s.
En effet, en Italie, l’accès à l’avortement ne concerne pas seulement les droits civils, il met aussi en évidence les inégalités sociales, les disparités territoriales, les pressions culturelles et l’instrumentalisation de la santé publique à des fins idéologiques, un phénomène de plus en plus fréquent.
Un parcours semé d'embûches
En outre, les informations relatives aux procédures pour accéder à l'avortement sur les sites ministériels et ceux des établissements hospitaliers ne sont ni claires ni à jour, et les délais d'attente peuvent être épuisants. De nombreuses femmes subissent aussi des violences physiques et psychologiques de la part du personnel de santé : elles sont obligées d'écouter les battements du cœur du fœtus, ne reçoivent pas les analgésiques demandés et sont hospitalisées dans les mêmes chambres que les femmes en plein travail. Les entretiens obligatoires avec des psychologues ou des psychiatres les invitant à reconsidérer leur décision sont également fréquents. Qui plus est, l'objection de conscience pour des raisons morales ou religieuses est si répandue dans certains territoires de la Péninsule que de nombreuses femmes sont contraintes de se déplacer hors de leur région pour pouvoir avorter : à Caserte, 80 % des gynécologues refusent de procéder à ce geste opératoire ; en Sicile ce pourcentage s’élève à 85 % (3).

Selon la philosophe Chiara Lalli, experte en bioéthique et auteure du livre La verità vi prego sull’aborto (La vérité, s’il vous plait, sur l’avortement), il y a en Italie quinze hôpitaux avec 100 % de gynécologues objecteurs de conscience et vingt qui en comptent plus de 80 %. « Cela crée une injustice sociale, puisque celles qui ont les moyens et les contacts finissent par se faire avorter, quitte à s’éloigner de chez elle, écrit-elle. Mais qu’en est-il des autres ? Et pour les avortements thérapeutiques, après 12 semaines, c'est encore pire. Tout le monde sait que celles qui en ont les moyens vont à l'étranger ».
En 2024, un amendement proposé par Frères d'Italie a été jusqu’à légaliser la présence des pro-vie dans les hôpitaux et les dispensaires.
Une autre donnée inquiétante concerne les avortements clandestins : selon les estimations du ministère de la Santé chaque année en Italie, entre 10 000 et 13 000 femmes y ont recours en prenant sans contrôle médical des médicaments achetés en ligne. Ce chiffre, calculé à partir des statistiques, ne tient toutefois pas compte des migrantes, dont le nombre d'IVG pourrait dépasser les 5 000.
Une expérience qui n'est pas forcément traumatisante
Alors que l'avortement a finalement été inscrit par le Parlement européen dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il demeure un tabou en Italie, un sujet que l’on évoque peu et à contrecœur. Les femmes qui font ce choix pour des raisons personnelles sont encore victimes d'une forte stigmatisation sociale, tandis que celles qui y sont contraintes pour des raisons médicales font l’objet de compassion à cause de la souffrance que cela implique. « On ne parle pour ainsi dire jamais d'avortement. Quand cela arrive, on baisse les yeux et le ton. À moins qu'il ne s'agisse d'un débat politique, auquel cas les propos sont enflammés et les termes apocalyptiques : ‘massacre des innocents’, ‘génocide légalisé’, ‘femmes meurtrières’, précise Chiara Lalli. Même celles et ceux qui sont favorables au droit à l'avortement et à la liberté des femmes de choisir ont du mal à se sentir à l’aise sur cette question. On s'empresse souvent de dresser une liste de circonstances atténuantes pour justifier le choix d'avorter, avant d'ajouter : ‘tout le monde sait bien que c'est un traumatisme’ ».
De son côté, la psychothérapeute et activiste transféministe Federica Di Martino tente de renverser ce discours catastrophiste et culpabilisant avec la plateforme «IVG, j'ai avorté et je me sens très bien » qui recueille, depuis 2018, des témoignages positifs. Elle diffuse aussi des informations utiles et appuie des pratiques collectives et populaires d’entraide, afin d'apporter un soutien économique, logistique et psychologique à celles qui décident d'interrompre leur grossesse. « La douleur et la culpabilité ne sont pas inscrites dans notre destin, encore moins la honte… Nos choix personnels n’appartiennent qu’à nous ; enfin, rappelons-nous que revendiquer un service adéquat et une assistance digne d'un pays civilisé n'est pas une option, mais un droit fondamental », commente-t-elle sur Instagram. Et de renchérir : « Nous existons, au même titre que nos histoires d'avortement, qui méritent la même considération que toutes les expériences d'autodétermination sur nos corps ».
1) Gabriele Barbati, « Contre ma volonté. Avortements impossibles, enterrements de fœtus et autres scandales » (Paesi Edizioni, 2024).
2) Le Garant pour la confidentialité est l'autorité nationale de contrôle chargée de l'application du règlement général sur la protection des données personnelles de l'Union européenne.
3) Le dernier rapport du ministère de la Santé au Parlement sur l'application de la loi 194 remonte à 2022 et se base sur les données de 2021.
Image principale: « Aujourd'hui, plus de 40 ans après l'adoption de la loi 194, le droit des femmes de choisir est toujours menacé et il est temps de se battre à nouveau », dénonçait Emma Bonino en 2021. La sénatrice du Parti radical a soutenu la campagne « Libera di abortire » (Libre d'avorter) afin de reconnaître l'avortement comme un droit reproductif et de garantir un accès libre et sans obstacle jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Source : Internet.
Cet article a été réalisé grâce au soutien du Bureau de Tunis de la Fondation Rosa Luxembourg.