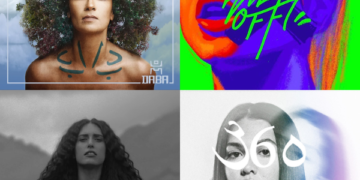Cette publication est également disponible en : العربية (Arabe)
Membres du collectif Tawhida Ben Cheikh lors de la conférence sur le droit à l’avortement à Tunis. Crédit photo : Hajer Ghammaqi
À l'occasion de la journée mondiale pour le droit à l'avortement sécurisé, le 28 septembre, le collectif Tawhida Ben Cheikh a tenu une conférence de presse à Tunis. La Tunisie, seul pays du monde arabe à avoir légalisé l'interruption volontaire de grossesse (IVG), célébrait le 52e anniversaire de sa loi, en vigueur depuis 1973. Néanmoins les organisateurs ont mis en lumière les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes cherchant à accéder à l'avortement, en particulier dans les établissements publics de santé.
Une rencontre pour rappeler un droit fondamental
Militantes, journalistes et acteurices de la société civile étaient présentes autour du thème :
« Pour une autonomie corporelle réelle : lever les obstacles à l’accès à l’avortement en Tunisie ».
Le collectif, qui porte le nom de la docteure Tawhida Ben Cheikh, première femme médecin en Tunisie et dans le monde arabe, réunit plusieurs associations féministes et organisations de défense des droits humains œuvrant pour la promotion des droits sexuels et reproductifs, et notamment du droit à l’avortement. Figure pionnière du militantisme médical et social, Ben Cheikh fut l’une des premières à revendiquer le droit des femmes à disposer de leur corps et à accéder à des soins de santé reproductive de qualité.
Au programme de la rencontre : retour historique et juridique sur le cadre légal, rappel de l’importance de ce droit dans la consolidation des libertés fondamentales, mais aussi analyse des obstacles sociaux, culturels, administratifs et médicaux qui freinent toujours son application.
La journée s’est achevée par la remise de prix aux lauréates et lauréats du concours annuel récompensant les meilleures productions journalistiques sur les droits sexuels et reproductifs — une manière d’encourager les médias à aborder ces sujets sensibles avec rigueur, profondeur et éthique.
Une fracture entre la loi et la pratique
La loi tunisienne n°53 du 11 juillet 1973 accorde aux femmes — qu’elles soient mariées, célibataires ou mineures avec l’accord de leur tuteur légal — la possibilité d’interrompre volontairement leur grossesse dans les trois premiers mois, gratuitement, dans les établissements publics de santé.
Au-delà de ce délai, l’avortement reste possible dans des cas précis : danger pour la vie de la mère, malformations graves du fœtus ou présence d’au moins cinq enfants vivants dans le couple.
Mais plus de cinquante ans après cette réforme pionnière, le constat est sans appel : le droit existe, mais sa mise en œuvre est entravée. Malgré un cadre juridique progressiste, les restrictions administratives, les pressions sociales et les réticences médicales se multiplient, vidant la loi de sa substance.
Sur le papier, la législation est claire et inclusive. Dans la pratique, l’accès reste semé d’embûches.
« Beaucoup d’hôpitaux publics exigent encore, en toute illégalité, l’autorisation du mari ou du père », déplore une militante.
D’autres établissements retardent les procédures, exercent des pressions psychologiques ou cherchent à dissuader les femmes d’aller au bout de leur démarche. Les témoignages recueillis évoquent aussi des attitudes stigmatisantes, voire violentes verbalement, de la part du personnel soignant.
« Le droit existe, mais il est entravé dans son application. Pour beaucoup de femmes, surtout les jeunes célibataires, l’avortement devient un parcours du combattant, éprouvant à la fois médicalement et psychologiquement », souligne Hédia Belhadj, présidente du collectif Tawhida Ben Cheikh.
Elle dénonce une mauvaise volonté manifeste dans certaines structures publiques et un refus implicite de pratiquer des interventions, notamment sur les jeunes filles.
Une enquête de terrain menée entre 2022 et 2023 par le collectif auprès de 5 800 jeunes hommes et femmes met en évidence une méconnaissance frappante du cadre légal : seuls 26,6 % des hommes et 45 % des femmes savent que l’avortement est autorisé en Tunisie.
Pire encore, 38 % des hommes et 31 % des femmes pensent à tort que les femmes non mariées n’y ont pas droit. Un chiffre révélateur du fossé entre la loi et sa perception sociale.
« Le droit existe, mais il est entravé dans son application. Pour beaucoup de femmes, surtout les jeunes célibataires, l’avortement devient un parcours du combattant, éprouvant à la fois médicalement et psychologiquement »
Opacité et restrictions en cascade
Pour Salma Hajri, présidente du collectif, la réalité de l’avortement en Tunisie échappe largement aux statistiques : « Les chiffres officiels ne concernent que le secteur public. Or, dans le privé, les interventions seraient trois fois plus nombreuses », explique-t-elle.
Les coûts y varient entre 300 et 500 dinars (90 à 150 euros) pour une aspiration chirurgicale, alors que l’acte est gratuit dans le public. Mais en l’absence de contrôle sur les cliniques, les dérives se multiplient : certains établissements pratiquent des avortements au-delà des délais légaux, jusqu’au cinquième ou sixième mois, exposant les femmes à de graves risques pour leur santé, voire leur vie.
Autre obstacle majeur : la pénurie de médicaments nécessaires à l’avortement médicamenteux, notamment le Misoprostol et la Mifépristone.
De nombreuses femmes, contraintes d’errer de centre en centre, se retrouvent face à des stocks épuisés. Faute d’alternatives, elles recourent parfois à des méthodes illégales ou à des services privés coûteux.
La situation est encore plus critique dans les régions de l’intérieur, où la faiblesse des infrastructures et le manque de spécialistes aggravent les inégalités.
Selon des données onusiennes, certains gouvernorats comme Tataouine ou Siliana ne comptent qu’un gynécologue pour 10 000 femmes, contre huit à Tunis.
À cela s’ajoute un problème de confidentialité : dans les zones rurales, la proximité sociale entre soignant.es et patientes compromet la discrétion et expose les femmes à la stigmatisation.
Entre stigmatisation et moralisme médical
Les obstacles ne sont pas seulement juridiques ou matériels. Ils sont aussi psychologiques et culturels.
De nombreux témoignages font état de violences verbales, de traitements humiliants ou de jugements moralisateurs.
Lors de la conférence, une sage-femme a reconnu que certaines de ses collègues tentent de dissuader les patientes, au nom de considérations personnelles ou religieuses.
Certains médecins, eux, estiment que l’avortement ne devrait être qu’un dernier recours, trahissant une vision paternaliste et culpabilisante du soin.
Ces pratiques, contraires à l’esprit de la loi, illustrent la persistance d’une culture du contrôle sur le corps des femmes, plutôt qu’une reconnaissance pleine de leur autonomie corporelle et décisionnelle.
Formation médicale insuffisante et inertie politique
Plus de cinquante ans après la légalisation, la formation des médecins et des sage-femmes demeure lacunaire et en décalage avec les évolutions scientifiques et juridiques. Un rapport du collectif souligne l’absence d’une approche fondée sur les droits humains dans les cursus, ainsi que le rôle ambivalent de certaines sage-femmes, qui deviennent parfois un frein plutôt qu’un appui.
Des initiatives existent pourtant. En 2013, le collectif a publié un Guide de formation en santé reproductive, suivi en 2024 d’un programme de formation pour 60 professionnel.les de santé.
Mais faute de suivi institutionnel et de volonté politique, ces efforts restent isolés et insuffisants.
Pour Hajer Nasser, trésorière du collectif, « le non-respect de la loi et les lacunes dans la formation du personnel médical aboutissent directement à la violation des droits des femmes ».
Plus de cinquante ans après la légalisation, la formation des médecins et des sage-femmes demeure lacunaire et en décalage avec les évolutions scientifiques et juridiques.
Entre acquis juridique et inertie de l’État
Cinquante-deux ans après la légalisation, la Tunisie vit une contradiction criante : une législation avant-gardiste, mais une application inégale et fragilisée.
Entre pénuries, inégalités régionales, stigmatisation sociale et absence de stratégie publique, le droit à l’avortement reste menacé.
Pire encore, l’absence de mécanismes de contrôle et de sanctions laisse impunis les soignants qui refusent illégalement de pratiquer des avortements ou imposent des conditions arbitraires.
En 1973, la loi tunisienne représentait une révolution juridique et sociale. Aujourd’hui, elle apparaît fragilisée par l’inertie étatique et les résistances conservatrices.
Entre texte progressiste et réalité restrictive, le droit à l’avortement demeure un combat inachevé. Il appelle plus que jamais à une volonté politique affirmée, une formation médicale fondée sur les droits humains, et des garanties concrètes pour assurer aux femmes un accès sûr, gratuit et respectueux de leur dignité.