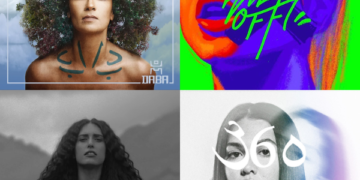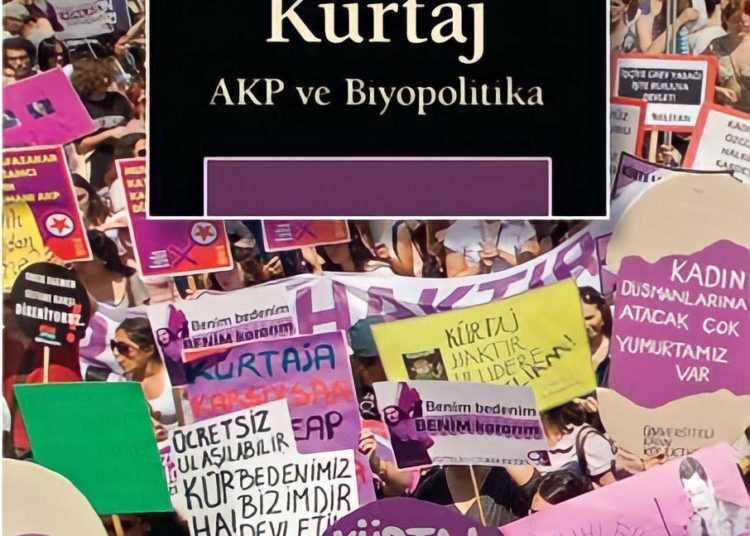Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Tábata Martín Olea
L'Italie, autrefois connue pour ses vagues d'émigration, a vu sa situation évoluer au fil des dernières décennies, devenant une destination de choix pour les migrants internationaux. Dès les années 1970 jusqu'aux années 1990, le pays a accueilli un nombre croissant de personnes venues du monde entier. Aujourd'hui, environ 8,7 % de sa population est composée de ressortissants étrangers, illustrant ce changement significatif.
Lorsqu'on évoque le terme « migrant », on pense souvent aux motivations économiques. L'Italie a longtemps été attractive pour ceux en quête de meilleures opportunités professionnelles, grâce à des politiques d'immigration relativement souples, une économie informelle florissante, des régularisations fréquentes pour les sans-papiers et une application limitée des expulsions. Pourtant, tous ne viennent pas uniquement pour un emploi : certains s'installent par amour, d'autres pour l'éducation ou les perspectives qu'offre le pays. En explorant les récits de trois femmes ayant choisi l'Italie comme nouveau foyer, on découvre les joies et les défis de l'immigration dans un pays réputé pour sa culture, mais aussi pour sa bureaucratie, son marché de l'emploi complexe et son mode de vie singulier.
Relations personnelles

Originaire d'Omsk, en Russie, Evgeniya, 31 ans, a quitté Saint-Pétersbourg pour s'installer à Rome, où elle a obtenu une licence et une maîtrise en histoire de l'art. Ce n’est pourtant pas sa carrière qui l’a menée en Italie. « J’ai choisi de donner la priorité à ma relation plutôt qu’à ma carrière. Mon mari vit à Rome », explique-t-elle. « C’est la seule raison de mon déménagement. »
Une fois installée, elle a vite découvert que le marché du travail italien, notamment dans le domaine artistique, était bien plus fermé qu’elle ne l’imaginait. « Naïvement, je pensais que ma maîtrise de l’anglais et du russe ferait de moi une candidate attrayante pour les galeries d’art. » Face à un marché difficile, elle s’est tournée vers d’autres opportunités. « J’ai distribué mon CV dans divers magasins, mais sans succès. » Finalement, elle a accepté un poste de serveuse dans un restaurant, où ses compétences en russe étaient utiles pour attirer les touristes. « Je voulais travailler, alors j’ai dit oui. »
Elle a rapidement découvert les défis du travail informel en Italie. « Sans contrat, tout se faisait en liquide, mais comme c’était temporaire, ça allait. » Au fil du temps, elle a enchaîné différents postes : vendeuse, maquilleuse indépendante pour mariages et séances photos, puis employée de bureau. Chaque emploi présentait des difficultés. « Les contrats étaient courts, parfois deux semaines seulement, et l’ambiance était toxique, marquée par des commérages et de la micro gestion. » Elle appréciait le maquillage, mais la COVID y a mis fin.
Aujourd’hui, Evgeniya a trouvé une certaine stabilité comme responsable de la garde-robe chez Fendi. « Ce n’est pas mon rêve, mais j’ai un contrat, un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et un environnement sain. Et le salaire est correct. »
En réfléchissant à son expérience, Evgeniya confie : « Les Italiens sont souvent peu ouverts d'esprit, notamment envers les étrangers. Pour décrocher un emploi, il faut connaître les bonnes personnes : tout repose sur les contacts. Le marché du travail est difficile, les salaires sont bas, et le coût de la vie augmente sans cesse. »
Perspectives éducatives
Tous les migrants en Italie ne rencontrent pas les mêmes obstacles. Bien que les étudiants étrangers représentent une faible part des effectifs de l’enseignement supérieur, le pays propose des programmes de mobilité internationale et des bourses dont ils peuvent bénéficier.
C’est le cas de Zahra [nom modifié pour des raisons de confidentialité], 34 ans, une étudiante en architecture originaire d’Arak, venue en Italie pour accéder à des opportunités éducatives inaccessibles dans son pays. Issue d’une famille bahaíe, elle explique : « En Iran, où l’islam est la religion officielle, nous rencontrons de nombreux problèmes. Les bahaís n’ont pas le droit de fréquenter les universités officielles, alors j’ai obtenu ma licence d’architecture à l’Institut bahaí d’enseignement supérieur (BIHE), un établissement clandestin. »
Souhaitant poursuivre ses études à l’étranger, Zahra a cependant été freinée par la non-reconnaissance internationale du diplôme de cet institut. « J’ai postulé à de nombreuses universités, mais elles m’ont refusée. Par chance, un ami m’a appris que l’Italie acceptait les diplômes du BIHE. Deux universités, à Pise et à Rome (La Sapienza), les reconnaissaient. J’ai donc candidaté à un master en restauration à La Sapienza, et ma demande a été acceptée. »
Même après son arrivée à Rome, Zahra a dû faire face à des obstacles bureaucratiques. « L’université menaçait d’annuler ma candidature, car l’ambassade d’Italie en Iran refusait de nous fournir la déclaration de valeur (DoV), un document officiel en italien confirmant la validité d’un diplôme. Heureusement, la communauté bahaíe de Rome est intervenue, et j’ai finalement été acceptée. »
Malgré ces défis initiaux, les choses ont fini par s’arranger. « J’ai obtenu une bourse régionale, la Lazio Disco. J’en avais entendu parler pour la première fois en Iran, grâce à des groupes d’étudiants iraniens qui étudiaient déjà en Italie ou projetaient de s’y rendre. Bien que ma famille m’ait soutenue financièrement ces trois dernières années, cette bourse m’a été d’une grande aide. »
Zahra envisage maintenant de poursuivre avec un doctorat, mais elle reste réservée sur le marché du travail italien. « J’aimerais travailler, mais les salaires sont bas, et beaucoup d’institutions n’emploient que des personnes maîtrisant l’italien. » Elle a été acceptée dans un programme de doctorat à l’université La Sapienza et a décidé de continuer ses études.
Son expérience illustre les limites du marché du travail en Italie, particulièrement pour les étrangers. Ce marché, hautement stratifié, privilégie les travailleurs peu ou semi-qualifiés, reléguant souvent les immigrés non occidentaux à des emplois subalternes, même s’ils disposent de qualifications élevées, limitant ainsi leur mobilité socio-économique.
Un autre défi majeur est la barrière linguistique. En raison de son histoire coloniale courte et de l’immigration limitée en provenance de ses anciennes colonies, l’Italie présente davantage de barrières linguistiques pour les immigrés comparée à d’autres pays européens.
Amoureuse de l’Italie

Certains nouveaux arrivants trouvent que le fait de maîtriser plusieurs langues est un atout majeur pour s’intégrer dans des marchés de l’emploi diversifiés. C’est le cas de Karina, 26 ans, originaire de la Transylvanie rurale en Roumanie.
Grâce à la mobilité au sein de l’Union européenne, elle s’est installée en Italie sans difficulté et a saisi les opportunités qui se présentaient à elle. Après avoir étudié le théâtre à Londres, Karina a passé un été à enseigner l’anglais et à jouer dans le nord de l’Italie, une expérience qui a renforcé son envie d’y vivre. « J’ai toujours été fascinée par la beauté de l’Italie, » confie-t-elle. « Après Vérone, j’ai décidé de poser mes valises ici. »
Trouver un emploi s’est avéré relativement simple. Elle a commencé comme professeure d’anglais, puis a travaillé dans le tourisme et le marketing à Rome. « Ces secteurs exigent un très bon niveau d’anglais, donc ma méconnaissance de l’italien n’a pas été un obstacle. Trouver un bon emploi peut être compliqué, mais décrocher un poste correctement rémunéré est assez faisable. »
Bien qu’elle n’ait pas ressenti de barrières linguistiques majeures, Karina admet que le réseau est crucial en Italie. « Ici, le marché de l’emploi repose largement sur les relations personnelles. Un bon CV ne suffit pas, il faut connaître les bonnes personnes. »
Cependant, elle critique la bureaucratie notoire du pays. « Obtenir le moindre document administratif est un cauchemar. Et je n’ai même pas besoin de visa, alors je n’ose imaginer ce que vivent les non-Européens. » Elle dénonce aussi les difficultés liées aux transports publics et au logement. « Les propriétaires rechignent à payer des impôts, ce qui rend l’obtention d’un contrat de location extrêmement compliquée. Mon prochain objectif est d’acheter un appartement à Rome, mais je sais que ce sera un défi. »
Malgré tout, Karina reste positive. « Rome a une manière bien à elle de laisser les choses se faire naturellement et lentement. C’est une leçon que j’apprends aussi. »
Cette enquête a été réalisée grâce au soutien de l’AGEE - Alliance pour l'Égalité de Genre en Europe.