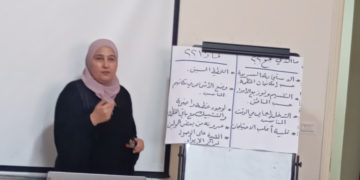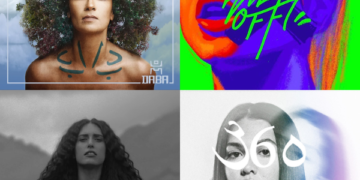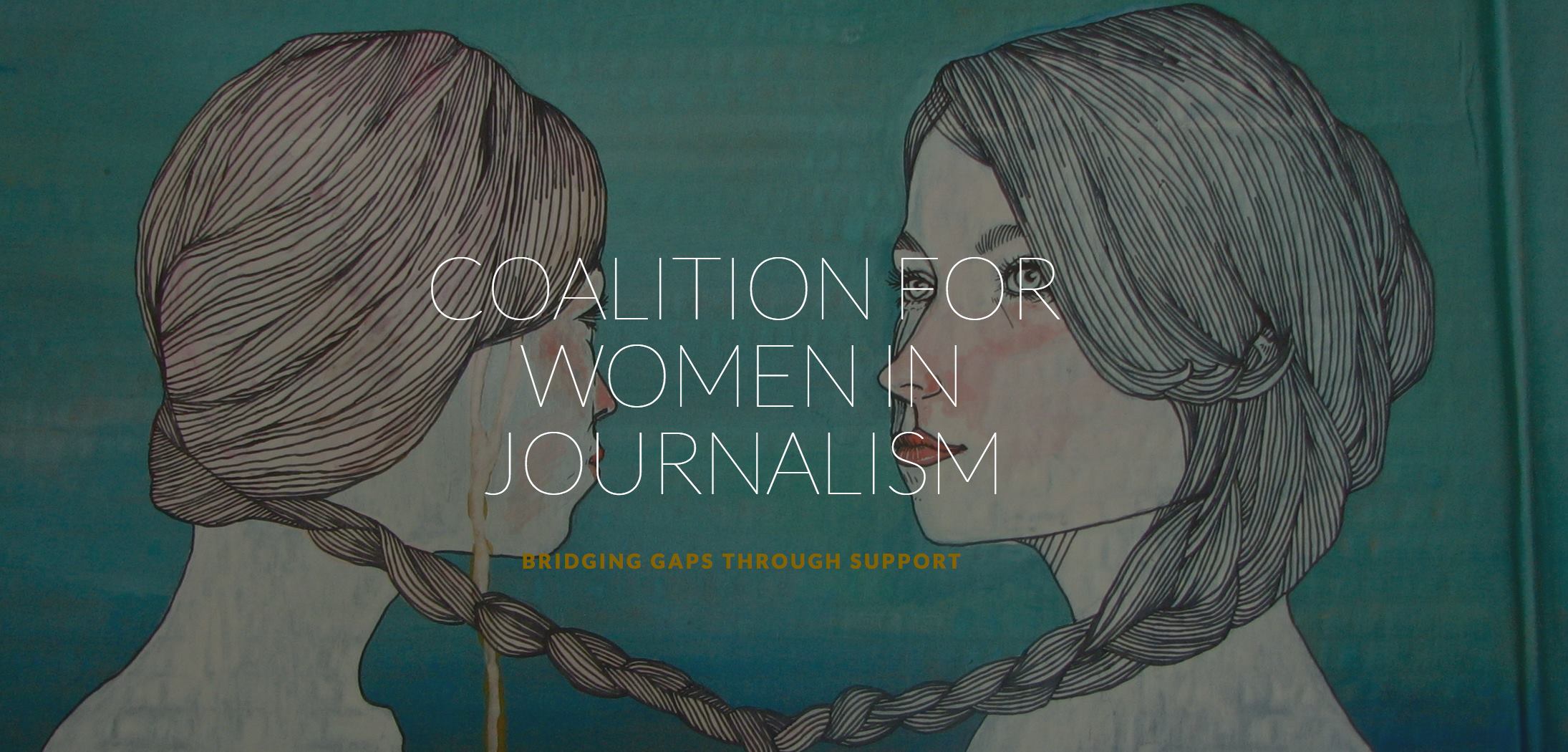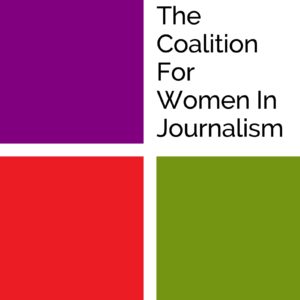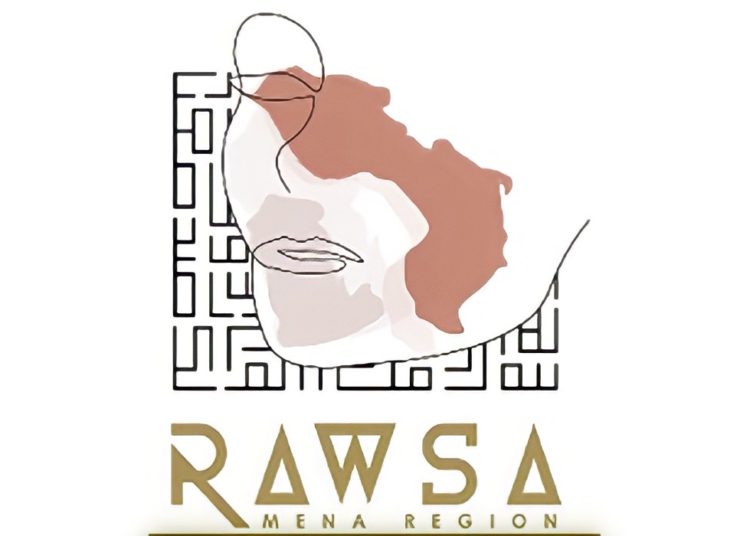Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Écrit par Övgü Pinar
Selon un rapport de la Coalition pour les femmes dans le journalisme (CFWIJ), la Turquie est le pays qui compte le plus grand nombre de cas de harcèlement judiciaire à l’égard femmes journalistes. Environ 80 % de toutes les poursuites documentées contre des femmes journalistes dans le monde en 2022 se déroulent en Turquie.
Destinées à intimider et à faire taire les critiques, les affaires SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation – poursuites juridiques contre la mobilisation publique) constituent une part importante de ces harcèlements judiciaires.
Les SLAPP sont une forme d’action judiciaire visant à entraver la participation publique et à dissuader la liberté d’expression autour des questions d'intérêt public. Ces procès constituent une menace importante pour le respect de la liberté des médias pluralistes et la création « d’un environnement favorable à la participation au débat public », selon un rapport publié par le Parlement européen.
À travers des formes de harcèlement judiciaire telles que les SLAPP portées par des acteurs puissants tels que des institutions étatiques, des agents publics, des organisations ou des personnes liées à l'État, « le processus judiciaire en soi sert de punition », déclare Ceren İskit, coordinatrice de recherche auprès du CFWIJ.
Le message est clair, s’aligner ou faire face à la colère de l’état
Ceren İskit souligne un « ciblage flagrant et systématique des femmes journalistes », et affirme que « le harcèlement judiciaire est l’une des violations les plus fréquentes à l’égard les femmes journalistes. Parmi les autres violations courantes figurent les détentions, les campagnes de trolls organisées et les attaques sur le terrain. »
Fondée en 2017, la CFWIJ est un réseau de soutien et de plaidoyer pour les femmes journalistes du monde entier, visant à combler le fossé entre les sexes en matière de liberté de la presse. Lancé en 2019, le projet Press Freedom Newsroom de la CFWIJ couvre 128 pays et enregistre les violations contre les femmes journalistes avec la publication de rapports réguliers.
Dans une interview relâchée à Medfeminiswiya, Ceren İskit, détaille la situation actuelle en Turquie :
Selon le dernier rapport « Press Freedom Status For Women Journalists » du CFWIJ, la Turquie est le pays qui compte le plus grand nombre de poursuites judiciaires contre les femmes journalistes. Pouvez-vous expliquer de quel genre de cas s’agit-il ?

Le harcèlement judiciaire est à la tête des cas que nous documentons et malheureusement, la Turquie se classe au premier rang, suivie par l'Inde, la Russie et la Chine. Depuis début 2022, nous avons documenté au moins 49 affaires judiciaires différentes à l’égard des femmes journalistes à travers le monde. Près de 80 % de ces affaires ont eu lieu en Turquie, dont 33 sont des poursuites pénales contre des femmes journalistes et six sont des poursuites civiles, y compris des affaires SLAPP.
Les femmes journalistes sont poursuivies soit en raison de leurs reportages, soit à cause des publications partagées sur les réseaux sociaux.
Comme nous l'avons observé en Turquie, les lois fréquemment utilisées pour harceler les journalistes sont les lois antiterroristes ou les lois « d'insulte » où les journalistes sont accusés « d'être membre d'une organisation terroriste », « de diffusion de la propagande terroriste » ou « d'atteinte à la réputation » de quelqu'un haut placé.
Ensuite, bien sûr, il y a les poursuites SLAPP intentées par des personnes puissantes contre des femmes journalistes.
Pouvez-vous expliquer la nature du « harcèlement légal », qu'est-ce qui constitue un harcèlement dans les affaires judiciaires ?
Le harcèlement légal, c'est quand la loi est délibérément violée et manipulée contre un.e journaliste pour dissuader les reportages critiques ou indépendants. Il opère par le biais de poursuites vexatoires, dans le cadre desquelles le processus judiciaire en soi sert de punition. Les femmes journalistes sont également harcelées et intimidées par le biais d’affaire SLAPP ou de fausses accusations criminelles portées directement par l'État, ou par l'intermédiaire d’institutions, voire de personnes liées à l’État. La façon dont le harcèlement se déroule varie au cas par cas - des détentions arbitraires et des convocations répétées sont utilisées pour harceler et traquer l'accusée durant toute l'enquête, les plaintes ou les témoins sont gardés secrets, l'accès légal est refusé et, souvent, les accusations exactes ne sont pas précisées non plus.
Lorsque le procès commence enfin, il se heurte à des retards ou à des changements de dernière minute sur le banc du tribunal. Des restrictions sont imposées et il y a un déni de justice systématique. Dans de tels cas, même s'il n'y a pas de condamnation, la journaliste est suffisamment persécutée pour qu'elle comprenne que les autorités ne sont pas d'accord avec ses reportages.
Ce processus ne vise pas seulement à réduire au silence les journalistes individuelles, mais aussi à décourager activement les reportages indépendants conduits par la presse et les médias d'information. Les raids de minuit, les détentions provisoires, voire les emprisonnements imposés par les tribunaux sont courants lorsqu'un.e journaliste fait face à de telles enquêtes judiciaires. En traitant un.e accusé.e comme un.e criminel.le, le tribunal peut imposer des interdictions de voyager ou d'autres restrictions judiciaires, en particulier dans les affaires déposées en vertu de la loi antiterroriste.
En Turquie notamment, les tribunaux prononcent souvent des peines de prison avec sursis en même temps qu'une condamnation. Cette peine, bien que permettant au journaliste d'échapper à la prison, pend au-dessus de leurs têtes comme une menace imminente. Lorsque vous évaluez ces tactiques dans leur ensemble, vous observez un ciblage flagrant et systématique des femmes journalistes. Ce processus est ce que nous appelons le “harcèlement légal”. Le message est clair, s’aligner ou faire face à la colère de l’état.
Qui sont les principaux auteurs de violations ou plaignants dans ces affaires judiciaires ?
Cela dépend de la nature de l'affaire, qu'il s'agisse d'une poursuite civile ou pénale. La plupart des affaires de harcèlement judiciaire visent les journalistes qui critiquent les politiques du gouvernement, à travers leurs reportages ou leurs publications sur les réseaux sociaux. Les principaux auteurs de ces violations font donc souvent l'objet de ces couvertures journalistiques. Il s'agit notamment des institutions de l'État, des hauts fonctionnaires, des personnes proches de ces fonctionnaires et de l'élite socio-économique. Les plaignants sont souvent des hommes politiques, des hommes d'affaires, des représentants d’appels d’offre et des personnes proches du pouvoir. Dans les affaires de terrorisme ou d'insultes en particulier, l'appareil d'État entre en action contre des femmes journalistes.
Votre recherche montre-t-elle des constantes particulières dans les violations contre les femmes journalistes ?
Oui. Le harcèlement légal est l'une des violations les plus fréquentes contre les femmes journalistes. Il y a d’autres violations courantes telles que les détentions, les campagnes de trolls organisées et les attaques sur le terrain.
Depuis le début de cette année, nous avons suivi 49 affaires judiciaires différentes à l’égard des femmes journalistes à travers le monde. Selon nos données, recueillies dans près de 30 pays à travers le monde depuis le début 2022, 19 femmes journalistes ont subi une forme de détention, 13 ont été attaquées par des campagnes de trolls en ligne ou des tentatives de diffamation organisées, et 11 ont été gênées sur le terrain.
Les femmes journalistes sont également victimes d’un sexisme flagrant, soit de la part de collègues reporters - généralement des hommes - qui leur sapent le moral en laissant entendre qu'une femme n'est pas assez « forte » pour porter l’équipement audiovisuel, ou de la part des rédactions qui évitent d’envoyer des femmes dans certains contextes en invoquant des problèmes de sécurité. Sur le terrain, elles sont exposées aussi à des formes de violence physique, y compris de la part de la police, alors qu’en ligne elles sont visées à travers un discours sexiste qui les cible en tant que femmes journalistes. Dans ces cas, tout et n'importe quoi, y compris les différences physiques, la situation familiale, la décision d'avoir un enfant, etc., peut être utilisée contre la journaliste.
Une configuration conçue pour épuiser les ressources d'un journaliste et l'intimider jusqu'au silence
Dans le cas de harcèlement judiciaire, notamment dans les affaires SLAPP, où le demandeur réclame des dommages et intérêts, une immense charge financière est imposée à la personne de la ou du journaliste individuel/le. Par exemple, dans l'affaire contre Çiğdem Toker, le tribunal a tranché en faveur du plaignant et infligé une amende de 30 000 livres turques (plus de 2 000 USD) en dommages non pécuniaires à la Fondation T3.
Le procès contre Çiğdem a été ouvert en représailles à la parution de son article sur le quotidien Sözcü qui a révélé des irrégularités budgétaires dans la gestion de la municipalité d'Istanbul. En février 2019, suite à la publication de l'article, Abdullah Demircan et Serkan Kaya, les avocats de la Fondation T3, ont déposé une plainte devant le tribunal civil de première instance d'Istanbul Küçükçekmece pour réclamer des dommages et intérêts. « Il faut s'interroger sur le patriotisme de la journaliste qui a rédigé cet article et des éditeurs qui ont publié son article » lit-on dans leur plainte. Après un procès qui a duré plus de trois ans, le tribunal a condamné Çiğdem à une amende. L'affaire elle-même ainsi que l'amende infligée à Çiğdem ont été conçues pour avoir un effet dissuasif sur elle, et sur tous les journalistes qui font tout simplement leur travail.
Le travail d'un.e journaliste consiste à demander des comptes au pouvoir et à dénoncer les méfaits ou malversations des fonctionnaires et des personnalités influentes de manière responsable. Cependant, le plus souvent, la loi est retournée contre les journalistes qui dénoncent les méfaits, souvent de corruption. Le ou la journalisme indépendant.e peut difficilement survivre lorsque la dénonciation des faits est considérée comme un acte criminel.
Même lorsque les journalistes ne sont pas condamnés, la décision intervient après une procédure judiciaire vexatoire entraînant des convocations répétées, des coûts socio-économiques et juridiques liés à leur implication dans de telles affaires et des retards dans le procès.
Cela implique l’existence d’un modèle manifestement conçu pour épuiser les ressources des journalistes et les intimider jusqu'au silence. Bien que l'impact du harcèlement juridique sur un.e seul.e journaliste soit certainement plus grave, nous trouvons souvent des tactiques similaires utilisées pour restreindre la capacité des petites publications indépendantes de fonctionner.
Pour quelles raisons les femmes journalistes sont-elles ciblées ? Quel est l’ampleur de ces tentatives d’intimidation ? Quelle est l'importance du rôle du sexisme ?
Les femmes journalistes ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que leurs collègues masculins. De plus, celles qui travaillent sur le terrain subissent souvent des discriminations fondées sur le genre.
Par exemple, une femme journaliste qui participe à une conférence de presse peut être exposée à de nombreuses discriminations physiques par rapport à son collègue masculin. Si une femme veut poser une question, la priorité est donnée à son collègue masculin. Si elle vient filmer une conférence, les hommes s’empare souvent du premier rang, ce qui peut l’empêcher de faire son travail. Une rédaction peut préférer éviter que les femmes journalistes ne se rendent dans certains quartiers pour des raisons de sécurité. En d'autres termes, alors que les femmes journalistes peuvent faire des choses au-delà de l'identité « féminine », dans le cadre de leur travail, elles se retrouvent toujours confrontées à ce système patriarcal.
Donnons un autre exemple : lorsqu'elles se rendent à un entretien, elles peuvent être harcelés par la personne interrogée. Nous ne pouvons pas limiter cette question aux seules femmes journalistes de terrain. Les horaires de travail, les inégalités de salaire et les normes d’identité attribuées aux femmes peuvent même les pousser à quitter leur emploi. En règle général, dans de nombreux pays, les femmes journalistes sont souvent tenues à l'écart et empêchées de faire pleinement leur travail. Bref, la discrimination sexuelle est le plus gros problème auquel les femmes journalistes doivent faire face.