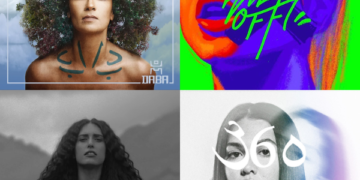Affiche du film Muganga, de Marie-Hélène Roux
Il faut du courage pour regarder Muganga. Celui qui soigne, le nouveau film de Marie-Hélène Roux, sorti en France dans les salles le 24 septembre 2025.
Conçu comme un biopic à la fois politique et humaniste, Muganga s’inspire librement du parcours du Dr Denis Mukwege, gynécologue congolais et lauréat du prix Nobel de la paix en 2018. Le film retrace le destin d’un homme confronté à des menaces constantes durant la première et la deuxième guerre du Congo, survenues dans les années 1990 — la seconde prenant officiellement fin le 30 juin 2003. Ces conflits, situés au cœur de l’Afrique centrale, s’inscrivent dans un contexte historique profondément marqué par des tensions ethniques, politiques et géopolitiques d’une extrême complexité.
Animé d’une foi inébranlable, le Dr Muganga n’a cessé d’être fidèle à sa mission : réparer les femmes, témoigner, dénoncer l’horreur, faire de la médecine un acte de résistance.
C’est un film nécessaire, insoutenable parfois, tant certaines scènes de viol, de destruction et de douleur sont d’une intensité insupportable. Mais comment détourner le regard, quand tant de femmes n’ont, elles, jamais eu ce luxe ?
Marie-Hélène Roux, réalisatrice française née au Gabon, signe ici une œuvre courageuse qui refuse le confort du spectateur.
Dix ans pour filmer l’horreur
Muganga a mis dix ans à voir le jour.
Marie-Hélène Roux a raconté avoir rencontré de nombreux refus : producteurs frileux, distributeurs effrayés, financiers convaincus que le public ne supporterait pas la violence du film. On lui a conseillé d’« adoucir » certaines séquences, d’en atténuer la brutalité. Elle a refusé.
Cette fidélité au réel, cette exigence morale, donnent au film toute sa puissance : Muganga refuse l’indifférence. Il refuse la complaisance.
Certaines scènes sont éprouvantes. Des spectatrices et spectateurs sortent parfois de la salle en larmes, bouleversés, épuisés. Mais la violence du film ne se limite pas aux images : les dialogues et récits entendus sont tout aussi atroces. On y entend le Dr Mukwege, incarné par l’acteur ivoirien Isaach de Bankolé, raconter que des femmes sont violées à coups de machettes, de matraques ou de couteaux, que certaines ont reçu une balle dans le vagin à bout portant, que des petites filles et même des bébés sont victimes de viols. Les explications médicales des chirurgies réparatrices sont bouleversantes, détaillant les gestes chirurgicaux nécessaires pour réparer ces corps mutilés.
Tout cela demande au spectateur une attention et une empathie sans concession. Le film nous oblige à regarder le réel sans filtre, à entendre le cri des femmes, à mesurer le courage de celles et ceux qui, comme Mukwege, choisissent d’agir au lieu de détourner le regard.
Pour autant, le film n’enferme pas les victimes dans une victimisation plate ; il montre aussi la résilience, la sororité, les solidarités locales et l’action de celles et ceux qui, à l’hôpital et au-delà, travaillent pour réparer et témoigner.
Le corps des femmes, armes et enjeu d’un conflit mondial
Ce film ne se contente pas de raconter une tragédie humaine : il expose une stratégie politique.
Le viol n’y est pas présenté comme une atrocité isolée, mais comme une arme de guerre destinée à terroriser la population, détruire la cohésion communautaire et imposer l’omerta.
« Pourquoi ces femmes ne sont pas tuées ? » demande une voix dans le film.
« Parce qu’une morte ne parle pas. L’objectif est la terreur. »
Cette réplique, d’une violence sèche, condense toute la logique du conflit : réduire les corps au silence tout en maintenant la peur comme outil de domination.
Cette violence systémique sert un objectif précis : le contrôle des zones minières riches en coltan, cobalt et or, dont l’exploitation alimente une économie mondialisée.
Le coltan, par exemple, est un minerai essentiel à la fabrication de nos téléphones portables, ordinateurs et autres technologies numériques. La République démocratique du Congo en détient la majorité des réserves mondiales, ce qui fait de son territoire un enjeu stratégique majeur. Derrière la souffrance des femmes se cache ainsi un marché mondial dépendant de ces ressources.
Le viol n’y est pas présenté comme une atrocité isolée, mais comme une arme de guerre destinée à terroriser la population, détruire la cohésion communautaire et imposer l’omerta.
Le combat du Dr Mukwege tisse le fil entre les crimes commis dans les villages congolais et les mécanismes économiques qui nourrissent les conflits. Mais ce combat n’est pas sans coût. Mukwege a survécu à plusieurs attaques, reçoit des menaces de mort récurrentes, et sa famille vit sous protection.
Le film rend visible une vérité dérangeante : celle de la chaîne de complicité silencieuse qui relie nos modes de consommation à des corps violentés à des milliers de kilomètres.
Une tragédie qui traverse les décennies
Alors que le film retrace le combat du Dr Mukwege entamé dans les années 1990, sa sortie en salle résonne tragiquement avec l’actualité : rien, ou presque, n’a changé.
Dans l’Est de la République démocratique du Congo, plus de 100 groupes armés, dont le M23, continuent de semer la terreur. Les villes stratégiques comme Goma et Bukavu ont été attaquées, entraînant le déplacement de centaines de milliers de civils. Les Nations unies, Amnesty International et de nombreuses ONG documentent une recrudescence des viols collectifs, des mutilations et des enlèvements, dans une impunité quasi totale.
Mukwege, aujourd’hui encore, appelle à la mise en place d’un tribunal spécial pour la RDC, conformément aux recommandations du Rapport Mapping de l’ONU, afin que les crimes commis depuis trois décennies ne restent pas impunis.
Le film nous rappelle douloureusement que ces violences ne sont pas de simples souvenirs historiques : elles continuent de marquer des vies, de déchirer des familles et de révéler les rouages d’un système mondial complice.