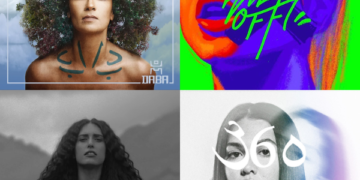Cette publication est également disponible en : English (Anglais)
Dans les ruelles étroites de Mina, la ville portuaire de Tripoli, se niche un festival international de cinéma. La capitale du Nord est pourtant la plus pauvre du pays et se trouve dans le top 3 des villes les plus pauvres du bassin méditerranéen.
Cette scène surréelle se déroule pourtant depuis 10 ans. Professionnels du métier, photographes et journalistes se sont mis sur leur 31 pour la soirée d’ouverture le 21 septembre 2023 du Tripoli Film Festival.
Jusqu’au 29 septembre, une large sélection de films et de courts métrages internationaux sont projetés au centre culturel Beit el Fan, dont le bâtiment a été construit par les Croisés au XIIe siècle.
Dans la catégorie court-métrage, ce sont les femmes qui dominent les productions libanaises. Leah Manasseh nous présente sa grand-mère, qu’elle a filmée deux semaines avant son décès, dans un film poétique et intime, Leila and the Cigarette. Dans The Sun Sets on Beirut, Daniela Stephan part à recherche de son chat dans les décombres de l’explosion. Quant à Marilyne Naaman, elle nous emmène à Beyrouth au milieu de la nuit dans son film So Cool. Une présence féminine qui reflète celle dans l’industrie du cinéma.
Envers et contre tout, le festival a tenu comme un symbole de lutte du secteur au Liban. Il faut dire que le Liban a traversé la thawra (révolution) en 2019, la pandémie de COVID-19, l’explosion du port de Beyrouth en août 2020 et une crise multidimensionnelle. Résultat, les lieux de production ou autres ont été balayés, la livre libanaise a perdu 95 % de sa valeur et 82 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Face à cette situation, les artistes demeurent et se réinventent. Proposant de nouvelles idées pour faire du cinéma, partager des films et surtout retrouver des espaces perdus. Et nombre de ces propositions sont portées par des femmes.
Ce que la crise a changé
Les professionnels du secteur sont formels : la situation a toujours été difficile et le cinéma n’a pas attendu la crise pour créer des films bricolés avec peu de moyens. « Mais depuis 2019, il y a des problèmes d’électricité, d’argent à trouver, l’impossibilité de retirer de l’argent ou de faire un prêt à la banque, etc. », énumère Charlotte Schwarzinger, qui écrit sa thèse de doctorat sur la scène cinématographique libanaise de 2019 à 2023.
Ceux et celles qui le peuvent sont déjà partis.e. ou s’y préparent et les autres ne peuvent que rêver à une vie meilleure ailleurs. On parle d’ailleurs d’une troisième grande vague d’émigration dans l’histoire du pays. « Ce ne sont pas seulement les réalisateurs qui sont partis, mais aussi des techniciens et des personnes aux compétences uniques et essentielles », explique Charlotte Schwarzinger.
Au-delà des départs qui déboussolent, il y a aussi l’incapacité à se projeter. « Un film cela prend des années, comment se projeter quand tout autour de toi est incertain ? », se demande la chercheuse.
Faire avec ce qu’on a
Tous ces bouleversements, la réalisatrice tripolitaine Rania Rafei les a vécus personnellement et dans son travail. Rencontrée dans un café de Mina, elle partage son expérience, mais aussi la révolution qu’elle perçoit dans le cinéma libanais depuis 2019.
« Quand la thawra a commencé, j’ai pris ma caméra et j’ai filmé. Mais j’étais très aliénée », raconte-t-elle. S’en suivent ensuite une introspection sur sa légitimité et sa place en tant qu’artiste, ainsi qu’un passage à l’université et l’écriture d’une thèse.
Depuis, elle défend fermement l’idée « de ne pas faire comme l’Occident ». Ce qui était circonstanciel avant est devenu son protocole. « Je ne peux sortir du marché, mais je ne veux pas être dépendante. Donc je fais avec ce que j’ai », affirme Rania Rafei. Une manière de faire qu’elle semble percevoir ailleurs dans le secteur, « grâce à la crise, qui donne un sens aux gens ».
Une multitude d’idées
La cinéaste énumère les initiatives qui tentent de faire différemment, pour retrouver ces lieux désertés et, surtout, les moments interrompus par les crises. À commencer par la réhabilitation du cinéma Empire à Tripoli, alors que la ville ne comptait plus aucune salle. L’un des premiers cinémas de la ville se trouve au milieu de la vibrante place de l’horloge à Tripoli.
À Beyrouth, les projets sont pléthore : Nation Station, le cinéma-club de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA), FUEL, ou encore les soirées films du café-librairie Barzakh, projetant des films indépendants.
La Fondation Liban Cinéma a aussi été lancée pour soutenir le cinéma libanais et mettre en relation les professionnels. Autant d’initiatives qui ramènent le dialogue et contrent le manque de fonds. « On n’a tellement plus rien qu’on travaille ensemble au local », précise Charlotte Schwarzinger.
L’esprit du cinéma
Le travail collaboratif, c’est une seconde nature pour Sabine Sidawi. « J’ai toujours fonctionné comme cela. Je n’aime pas la compétition », affirme cette productrice de documentaires et de longs métrages.

La passion du cinéma. C’est de cela que déborde Sabine Sidawi, dans chacun de ses mots comme dans sa réflexion confiante et son sourire rassurant. Basée à Beyrouth, elle appartient à une coopérative de cinéma initiée en 2020, deux semaines après l’explosion du port. « La révolution nous a appris qu’il ne fallait pas attendre que les solutions tombent des arbres, il faut les trouver ensemble », explique-t-elle dans l’immense appartement loué pour la coopérative dans le quartier Furn el Chebbak.
Aujourd’hui composée de 7 personnes, la coopérative pourra compter jusqu’à 25 ou 30 professionnels du cinéma, pour partager les savoirs, les expériences, chercher du travail et de l’argent ensemble. « L’important, c’est de se réunir et de garder les cerveaux. On a tous des expertises, mais on travaille chacun dans notre coin », déplore la productrice pour qui « le travail collectif, c’est ça l’esprit du cinéma ».
Et ce partage est pour elle une seconde nature. D’ailleurs, plus qu’optimiste, elle est déterminée : « Il faut avoir de l’espoir. Faire du cinéma ne demande pas beaucoup contrairement à ce que le capitalisme fait croire. Cela ne peut durer, il faut faire différemment ». Son rêve, que ce modèle de coopérative se reproduise partout au Liban et que sa structure soit « autosuffisante dans 3 ans ».
L’IMDb (Internet Movie Database) du cinéma libanais
Quelques quartiers plus loin, à Mar Mikhaël, Hania Mroué, la charismatique directrice de l’association de cinéma d’art Metropolis nous reçoit pour évoquer leur nouveau projet. Promouvant le cinéma au Liban, l’organisme a toujours soutenu la protection de la mémoire et s’est donc naturellement lancé dans la création d’une cinémathèque. « J’appelle cela un IMDb du cinéma libanais », sourit la directrice. Actuellement, seule la recension de films libanais et des réalisateurs est disponible sur leur site web.
« Après le lancement du site, des gens nous ont appelés pour nous demander comment ils pouvaient regarder les films », raconte Hania Mroué. C’est ainsi qu’a émergé l’idée d’avoir un lieu pour la cinémathèque. Pour l’instant, les films sont seulement disponibles sur un serveur, depuis un lien, à consulter dans les locaux de Mar Mikhaël. « Le rêve serait d’avoir un jour les moyens de faire des copies physiques de ces films et de les conserver », poursuit-elle.

Aujourd’hui, la directrice réfléchit justement à des manières de travailler avec les autres professionnels. Pour elle, l’avenir est dans la collaboration : « Nous ne sommes pas en concurrence, mais en complémentarité. Les besoins sont si énormes qu’il y a de la place », affirme-t-elle.
Plus prudent, moins financé, à plus petit cercle, en mutualisant les savoirs, le cinéma libanais use plus que jamais de ses tactiques de survie. S’il n’a pas attendu les trois dernières années de crise pour connaître des difficultés, ces dernières semblent, en revanche, avoir créé une multitude de révolutions personnelles et locales.