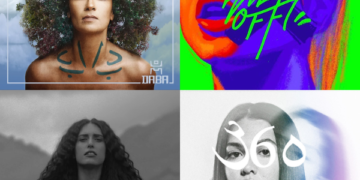Cette publication est également disponible en : English (Anglais)
Vous avez tenu à vous présenter en tant que chercheure lesbienne dès le début de votre intervention. Pourquoi est-ce important pour vous de dévoiler votre identité sexuelle y compris dans un cadre scientifique ?
En fait, on a été socialisé en tant que chercheur.e.s à se détacher ou à se désincarner des objets de recherche sur lesquels on travaille. Personnellement je milite en faveur d’une science beaucoup plus engagée, où l’on se positionne en prenant acte de qui on est. Pas pour donner une légitimité à ce qu’on fait, car je pense qu’une personne non concernée directement par les enjeux de la sexualité peut très bien se pencher sur les communautés LGBT et présenter un travail très respectable.
Se positionner toutefois par rapport à ce sujet est important à mon avis, d’autant que mes recherches portent sur des personnes queer comme moi et que ce partage d’identification n’est pas anodin. Je le fais aussi parce que d’une part je suis dans un contexte safe qui le permet et parce qu’historiquement les minorités sexuelles de genre ont été exclues des rencontres académiques. C’est donc là un acte de militance et de réappropriation de revendications dans un univers où nous avons été, à une certaine époque, éjectées.
Que peut une chercheure lesbienne qui travaille dans le domaine des solidarités queer pour faire avancer cette cause ?
C’est une exigence de transparence envers nos communautés que nous devons à nos communautés. Il est important de se poser plusieurs questions à ce niveau. Que fait-on de nos recherches ? A qui servent-elles ? Quelle diffusion peut-on leur garantir ? Parlent-elles un langage accessible ? Donnent-t-elles la parole aux personnes concernées ? Ce sont les réponses à ces interrogations qui peuvent marquer notre contribution pour une meilleure solidarité avec nos communautés.
Un de mes objectifs consiste à défaire les frontières entre les militants LGBT, les acteurs communautaires et l’université...
Mais le milieu académique ne demeure-t-il pas élitiste malgré toute la bonne volonté de ses chercheur.e.s engagé.e.s?

Il est vrai que ce milieu reste privilégié. Ce serait hypocrite de dire que mon activisme s’incarne seulement dans les articles que je vais publier et qui finalement vont servir ma propre carrière. Mais je ne veux pas non plus tomber dans un jugement de valeur : à chacun.e. de développer ses propres capacités de s’impliquer ou pas dans la cause queer.
Les enjeux de sécurité sont capitaux ici, ceux des impératifs et des conditions de vie également. Pour parler de mon cas : j’ai une petite fille de sept ans, qui va être prioritaire dans l’organisation de mon temps. D’où le fait qu’a certains moments je serais moins impliquée dans les mouvements communautaires que d’autres. Je suis toutefois d’accord pour dire qu’il faut réfléchir au-delà du monde académique pour diffuser nos résultats.
L’organisation de colloques où on peut ouvrir le dialogue, associer les milieux communautaires et mettre en relation les militants et les chercheur.e.s me semble une bonne stratégie. D’ailleurs un de mes objectifs en rapport avec ma carrière académique consiste, en toute humilité, à défaire les frontières entre les militants, les acteurs communautaire, défavorisés du point de vue social, et le milieu universitaire, toujours encensé du point de vue symbolique et économique. Cet objectif ne fait pas consensus.
Au cours de ce colloque, on a beaucoup évoqué le mythe des solidarités queer transnationales en donnant des exemples des discriminations rencontrées en occident par les communautés LGBTQ. Partagez-vous cette position ?
Oui, je la partage. On a parlé aussi du paternalisme des pays du nord quant à cette question, leur hypocrisie et leur double discours également. Mon collègue de l’Université de Montréal, Ahmed Hamila, a expliqué comment l’occident cherche à investir dans les droits LGBTQ des pays du sud, mais quand il y a un mouvement de déplacement des acteurs de la communauté vers ses pays, des barrières s’érigent.
J’ai personnellement vécu cet enjeu à travers les choix de mes parents qui ont émigré au Canada à la fin des années 60 dans un contexte qui se rapprochait beaucoup de l’assimilationnisme. Le bon migrant à l’époque était celui qui se blanchissait, adoptait rapidement la culture de la terre où il s’était établi. J’en ai ressenti des répercussions sur mon identité, d’ailleurs mon prénom francophone est un très bon exemple des pressions que mes géniteurs ont dû subir. Le processus d’altération que j’ai vécu dit beaucoup sur la violence d’un système qui ne fait pas vraiment place à la différence.