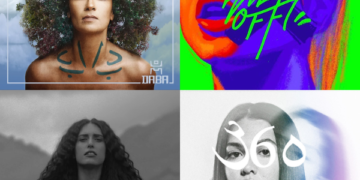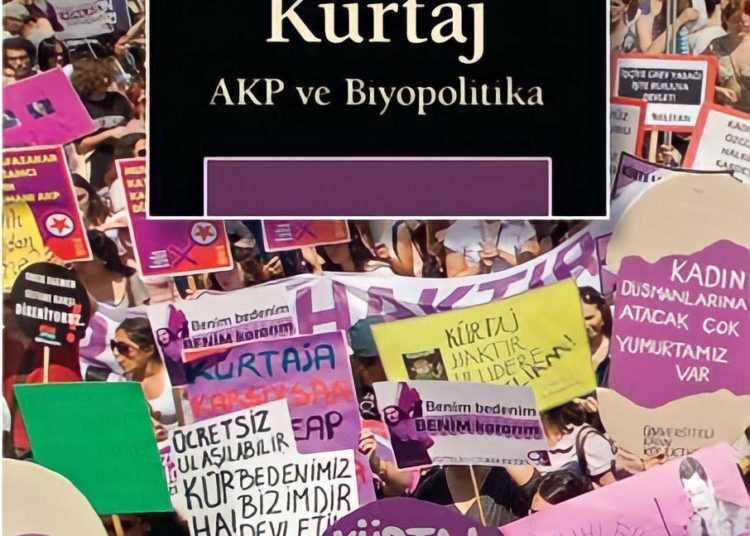Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
La nuit a été courte, balisée par le flot de mots et le récit de Nébiha, ses souvenirs, ses tourments, ses épreuves, ses espoirs. Sa résilience.

Je me lève bien avant l’aube pour couvrir le ramassage des ouvrières agricoles par les chauffeurs de camions. Une étape à haut risque, que les plus âgées des filles de Nébiha, ont expérimenté, lorsque lycéennes, au moment des vacances scolaires, elles allaient cueillir les olives ou les fruits dans les grands périmètres appartenant aux investisseurs-exploitants. Ces cinq dernières années et selon les chiffres du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, les accidents de la circulation en lien avec le transport de fortune des groupes de saisonnières/saisonniers dans les zones rurales ont fait 47 morts et 667 blessées. En avril 2019 un drame avait bouleversé l’opinion publique : le décès de treize ouvrier.e.s, dont 8 femmes dans un accident de route à Sabbala, pas très loin d’ici, dans ce même gouvernorat de Sidi Bouzid. Une famille entière, une mère et ses deux filles, y avait été décimée. Non assurées, non syndiquées, livrées aux insecticides à visage découvert, sous payées, rémunérées moitié prix en comparaison avec les hommes, leur labeur non comptabilisé par les statistiques officielles, elles sont des milliers à prendre chaque jour la route des champs, entassées les unes sur les autres. Au péril de leur vie. Ces armées de femmes assurent pourtant aujourd’hui la sécurité alimentaire des Tunisien.e.s au moment où les hommes désertent de plus en plus un secteur marqué par une stigmatisation et par la plus grande des précarités. Et la loi 51 sur le transport rural adoptée en 2019 par le Parlement visant à prémunir les journalières contre de telles catastrophes semble inadaptée au contexte de ces contrées.

Il fait encore nuit noire lorsque j’arrive, en compagnie de Nesrine Amri et d’Intissar Akrouti, qui me servent de guides, à 5h du matin à la station (informelle) de Régueb où s’arrêtent les karhbaji (les voituriers). Des transporteurs informels conduisant des véhicules, type 404 bâchées ou Isuzu souvent en fin de vie. Il gèle en cette matinée du 14 décembre, où la météo affiche des graduations quasi négatives. Tout dans l’apparence des centaines de femmes déjà installées dans les bennes des camionneurs montre leurs efforts pour se prémunir contre le froid, mais aussi contre… la convoitise des hommes. Avec sur le dos des Himalaya de vêtements, de leur silhouette ainsi déguisée s’efface tout « soupçon » de féminité. Comme une tenue de camouflage endossée pour affronter un champ de bataille.
Indignation, détresse et colère des ouvrières agricoles
Sur la tête une cagoule, au-dessus de laquelle elles cuirassent leur crane d’un bonnet en plus d’un foulard-hijab, elles tentent de se protéger ainsi des intempéries et de la nocivité des insecticides. Le corps entièrement invisible, il est couvert d’un large et vieux manteau. Au-dessous un jogging porté sur une ample robe. Des bas en laine et des bottes en plastique ou des chaussures usées appartenant à leur mari ou à leur fils complètent leur accoutrement.

Saloua, la trentaine bien entamée, à bord d’une voiture où s’empilent plus de vingt femmes s’insurge à ma vue : « Cela fait cinq années que vous nous soumettez à des enquêtes et études et que vous parlez de nous dans les médias. Qu’en avons-nous gagné ? Rien du tout. Nous continuons à recevoir des paies de misère. Une journée entière à travailler pour 10 dinars (3, 06 euros), excepté lors de la récolte des olives, entre octobre et janvier, où les tarifs s’élèvent un peu. Mais que peut-on faire avec une telle somme surtout si on en extrait les frais du transport ? Que peut-on faire avec un tel montant lorsque le prix de la bouteille de butagaz atteint les 8 dinars (2, 45 euros), le kilo de sucre 1dinar, 400 (0, 45 euros) et le paquet de lait 1dinar, 400 ? ».
Plusieurs femmes m'entourent. Détresse et colère se dégagent de leurs propos.
« Mon mari et mon fils sont au chômage. A Régueb, à part l’agriculture il existe peu d’opportunités d’emploi. Mais mon fils refuse de s’y engager estimant que le montant de la paye offerte par les propriétaires terriens ne vaut pas l’effort fourni. Je travaille aussi pour lui procurer de quoi se payer un paquet de cigarettes, j’ai peur qu’il ne se suicide comme tant de jeunes gens de Soug Ejjdid à côté de chez nous », se lamente Salha, 42 ans.
Khamissa, petite femme de 60 ans toute chétive et rabougrie, emmitouflée dans une couverture n’a pas la force de bouger de sa place dans une voiture à moitié pleine : « Les membres glacés, le nez, qui coule, harassées de fatigue après un trajet de plusieurs kilomètres supporté debout par manque de place, c’est ainsi que nous arrivons sur les exploitations. Le long de la route, accrochées les unes aux autres, jusqu’à une trentaine par voiture, nous tombons à chaque secousse. A chaque rencontre avec des agents de la garde nationale, nous tremblons de peur, peut-être arrêtera-t-on le chauffeur ou serait-ce l’épisode d’un nouvel accident suite à une course poursuite entre la police et le karhbagi ? Ayez un peu d’empathie pour nous ! Nos droits seront-ils un jour respectés ? ».

« Plutôt mourir du Coronavirus que de la faim ! »
Chauffeurs clandestins aux voyages non assurés, les karhbaji jouent en fait plusieurs rôles. Recruteurs des journalières, ce sont eux les intermédiaires principaux de tout le processus de l’emploi des femmes. Chacun son réseau d’ouvrières, ils les placent chez les agriculteurs, s’avancent comme leurs garants après avoir négocié le tarif de leur jornata (journée de travail). Un trafic qui s’apparente en tous points à de la traite. Quotidiennement au petit matin, les karhbaji font le ramassage des femmes, les déposent sur leur lieu de travail, les récupèrent l’après-midi, leurs avancent de l’argent pour acheter de la farine, de la semoule ou de l’huile. C’est à eux aussi que revient la tâche de les payer chaque dimanche, la veille du souk hebdomadaire de Régueb, après avoir récupéré leur salaire chez l’exploitant et prélevé leur dû, à savoir le prix du transport fixé en moyenne à 3 dinars par jour.
Mohamed Ennaji Ezzariî est à la fois karhbaji et agriculteur sur un périmètre de 14 ha. Bien sapé dans son burnous flambant neuf, il attend les dernières retardataires avant de parcourir 25 km pour arriver sur ses terres. Mohamed Ennaji Ezzariî fait partie des rares propriétaires terriens à transporter lui-même ses ouvrières : « Je les paye un dinar (à, 31 euros) de plus que les autres. Je ne peux pas aller au-delà, sinon je risque de monter tous les agriculteurs contre moi. Les hommes ? Bien sûr qu’ils sont rémunérés plus que les femmes. Ils sont plus forts et plus persévérants ! En plus aucun homme n’accepte de travailler pour 10 dinars ! ».
Zouhair Jellali, autre karhbaji présent à la station va se diriger avec à bord 25 femmes dans quelques minutes, à 6h 30, vers les terres de Naceur Lahmar, un des plus importants investisseurs de la région. Doté d’unités de transformation, d’emballage et de grands frigos, il exporte ses fruits vers de nombreux pays, dont la Russie.
Zouhair Jellali estime que les ouvrières agricoles sont des militantes dans la détresse : « Le prix du mazout coute cher et les distances sont grandes. En fin de compte, je ne gagne pas grand-chose moi non plus, notamment au vu de la pénibilité de mon travail : me réveiller à 3h du matin, risquer à chaque détour d’affronter la police, subir les dangers de la route. Mais ces femmes méritent plus que tous un meilleur traitement, elles qui n’arrêtent pas de trimer y compris pendant les périodes de confinement. Plutôt mourir du Coronavirus que de la faim, ont-elles choisi ».
Les femmes rencontrées à la station de Régueb revendiquent toutes des conditions de déplacement plus « dignes » et une rémunération moins « injuste »*. Des doléances exprimées dans une station faisant face au…Tribunal cantonal de la ville !
Mais il fait encore sombre lorsque partent les camions de la mort et l’ombre de la nuit couvre du voile de la duplicité une longue chaine de discriminations…
Amitié, solidarité, sororité
Zouhair Jellali accepte que nous le suivions sur les lieux où s’activent « ses » saisonnières. Il appelle toutefois auparavant le chef de secteur de l’exploitation, le responsable refuse net tout échange avec la presse. Toute éventuelle prise d’images. Ce refus, nous l’essuierons à trois autres reprises, sur trois autres champs. Nous finissons par revenir à Sidi Ameur, où Farid Amri, cousin germain de Nesrine, petit agriculteur de 28 ans cultive sur la terre de son père pieds d’oliviers et quelques périmètres de carottes. Il est 7h00 du matin et Farid n’est pas encore arrivé. Deux femmes, Sana et Amel, ramassent des brassées de branches pour allumer le feu et se réchauffer avant de commencer leur labeur.
Sana, visage riant et belle bouille est âgée de 32 ans. Elle habite à un kilomètre de là avec son mari, membre des Amri également. Revient encore la même litanie des besognes quotidiennes réalisées dès l’aube : traire les deux vaches, entretenir le potager, s’occuper du bébé et des deux enfants avant leur départ à l’école, préparer le petit déjeuner du mari. Toutefois, Sana, elle, n’a pas à endurer la corvée du transport, ni l’obligation de soustraire de ses 15 dinars quotidiens le tarif du karhbaji. En plus, un lien de partage, d’amitié, de solidarité et de soutien mutuel s’est tissé entre ses coéquipières et elle.

« Autant nous vivons un calvaire, avec l’arrachage des carottes et leur nettoyage alors qu’il gèle et que nos doigts sont figés par le froid et l’humidité du petit matin, autant l’ambiance, qui règne dans le groupe est joyeuse et bon enfant. Une ambiance allégeant à souhait la lourdeur de notre charge. »
Sana montre une grosse marmite couverte d’une planche en bois : « Toutes ensemble, nous y avons cuit la semaine passée, sur feu de bois, des plats succulents. Des macaronis aux légumes et à la viande, un ragout de petits pois à la viande de mouton et une kounafa, autre ragout d’habitude préparé à base de fenouils que nous avons remplacés par les carottes de ce champ. Un vrai régal, piquant et parfumé avec mille et une épices ! Nous les femmes, après avoir gouté à l’indépendance financière et au plaisir d’être entre nous, pouvons difficilement nous suffire de la seule vie de famille ».
Son mari, travailleur journalier à Régueb est convaincu que sa place véritable est dans son foyer plutôt que sur une terre : « “ Pourquoi rentres-tu énervée alors que dehors tu sembles si joyeuse et si pleine d’énergie. Demain tu restes à la maison ! ”, me menace-t-il à chaque fois que des conflits éclatent entre nous sous la pression de mon irritation inhérente à l’abondance des charges domestiques. Alors je prends sur moi et cabre mes accès de colère. Car le lendemain dès l’aube, je ne peux pas ne pas retourner dans les champs ! ».
De leur lieu de servitude, les ouvrières agricoles de Régueb tirent par la puissance du lien de sororité qui cimente leur jornata un élan d’autonomie. Une émancipation…