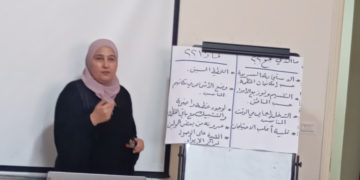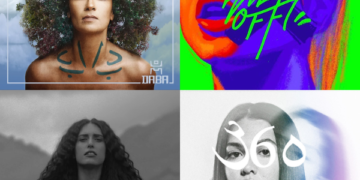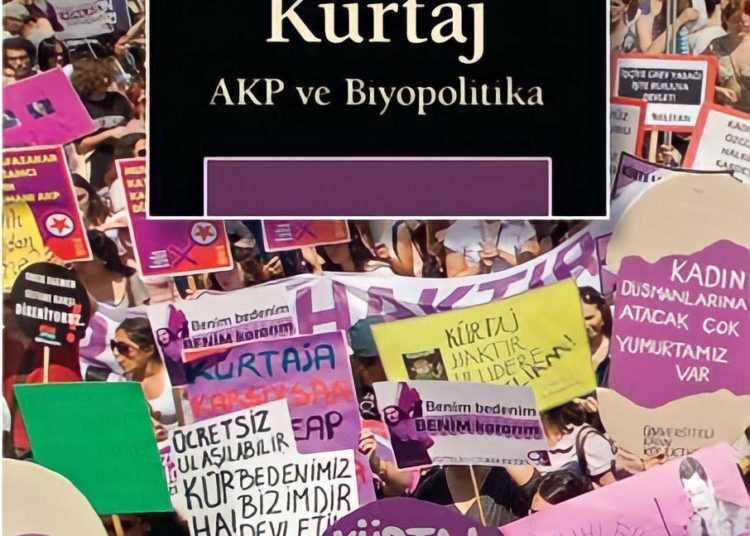Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Le samedi 27 février 2021, une marche puis un grand rassemblement sont organisés par le mouvement islamiste Ennahdha au centre-ville de Tunis. Le président de cette formation, Rached Ghannouchi, également président du Parlement, cherchait en organisant cet évènement à réagir contre toutes les attaques adressées à son parti, qui se sont exprimées lors des manifestations des jeunes des quartiers défavorisés depuis le début de l’année 2021. Dix ans après la révolution, aucune des revendications socioéconomiques brandies à ce moment-là n’a été réalisée. La colère exacerbée par la gestion du pays, catastrophique et plutôt partisane, de la formation de Rached Ghannouchi qui a pesé de tout son poids sur les rouages de l’Etat dix ans durant, s’est exprimée. Ainsi, une jeunesse désemparée, souffrant de chômage, de marginalisation et de désenchantement révolutionnaire, avait déployé ses slogans anti Ennahdha plusieurs soirées de suite sans que les interventions musclées de la police ne puissent cabrer le soulèvement.
Détresse et solitude des reporterres
Mais lors du rassemblement, organisé en pleine crise sanitaire et qui enregistre l’afflux de milliers d’adhérent.e.s et de sympathisant.e.s d’Ennahdha, des incidents graves surviennent : quinze femmes journalistes sont agressées, dont au moins cinq sexuellement. Ces incidents, probablement les premiers du genre en Tunisie, se sont déroulés en présence de policiers et de responsables du parti islamiste, qui ne sont pas intervenus pour mettre fin à ces abus. Pire encore ce sont les milices d'Ennahdha, déguisées à l'occasion en services d'ordre, qui ont braqué contre les journalistes femmes venues couvrir l’évènement une arme immonde. Victimes d'insultes à caractère sexuel et d'attouchements répétés, au moment où le chef du parti s’adressait aux foules devant le ministère du Tourisme, au centre-ville de Tunis, elles ont vécu un moment de grande détresse et d'infinie solitude.
Bien sûr le parti avait émis un communiqué pour affirmer qu'il s'agit de « dérives parsemées et individuelles ». Archi faux ! L'agression a été relevée largement : des photographes, des reporters télé, de radios privées et de sites l’ont subie. Certaines ont eu le courage de témoigner de ce qu’elles ont vécu, en cet après-midi du 27 février, à visage découvert, sur les réseaux sociaux.
Tout porte à croire que l’ordre pour exercer cette violence est par conséquent planifié et méthodique. Sûrement pour dissuader les journalistes femmes de revenir sur le terrain et d'exercer leur métier selon un de ses fondamentaux : le reportage. Sûrement aussi et surtout pour faire main basse sur leur liberté d'expression acquise à la faveur de la révolution. Car depuis toujours le corps des femmes est un terrain de bataille. Un champ d’honneur. L’éclabousser se répercute, notamment dans les sociétés arabo-musulmanes, non seulement sur l’individu mais aussi sur toute sa famille, sa tribu, sa communauté. D’autre part, ici l’enjeu de la conquête rêvée est de taille : celui de (ré)asservir les médias.
Deux mots d’injures
« Iîlam Al âr » (Médias de la honte), deux mots lancés aux journalistes des deux sexes en ce samedi noir (les hommes aussi ont été agressés par les agents de sécurité d’Ennahdha). « Iîlam al âr », une insulte récurrente envers les médias, ces dix dernières années, que les milices islamistes, incarnées par les fameuses Ligues de protection de la révolution, avaient déjà utilisé contre les journalistes de la télévision publique en 2012 au moment de leur sit in. Un sit-in, qui avait pris place devant le siège de la TV nationale le 2 mars 2012 et s’était prolongé jusqu’au 25 avril. Deux mois de campagnes d’injures jetées à la tête des reporters du journal télévisé, aux professionnelles femmes de la télé en particulier, accusées d’être à la botte de l’ancien régime de Ben Ali et de vouloir « saboter par leurs images négatives et partiales le travail du gouvernement dirigé par la Troïka ». Deux mois d’intimidations et de tentatives d’intrusion dans les salles de rédaction au bout desquels les sit-inneurs ont appelé à la …vente de la « télé de la honte » !
Malgré la prédominance féminine dans le secteur, et en particulier sur le terrain, l’accès des femmes journalistes aux postes de direction dans les médias tunisiens, qu’ils soient publics ou privés, ne dépasse pas les 11 %.
« Iîlam al âr », deux mots qui en disent long sur les frustrations d'un parti orphelin de caisses de résonnances édifiées à l'effigie de sa gloire. Et malgré les « médias de l’honneur », deux chaines télévisées, qu’Ennahdha a érigés dans l’illégalité pour se servir elle-même en se regardant dans son propre miroir, le parti n’arrive pas à contrebalancer une image encore plus ternie au fil des ans, face notamment à une gestion désastreuse de l’Etat et de ses diverses institutions.
Impunité des agresseurs
Ce samedi de la honte révèle une profonde volonté de bâillonner un métier en inhibant et attaquant sa moitié entière. Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait annoncé dans la soirée de samedi 27 février, sa décision de poursuivre en justice des membres du comité d’organisation de la marche d’Ennahdha. Le Syndicat s’est basé dans sa plainte sur l’article 14 du décret-loi 115 relatif à la liberté de la presse publié en novembre 2011 et qui stipule que quiconque : « offense, insulte un journaliste ou l’agresse, par paroles, gestes, actes ou menaces, dans l’exercice de ses fonctions, sera puni de la peine d’outrage à fonctionnaire public ou assimilé ».
« La volonté de protéger les journalistes, exprimée par la loi, reste cependant assez théorique : le fait qu’aucune mesure concrète n’accompagne la mise en application de l’article 14 le vide de toute effectivité. Au cours des incidents du 27 février le travail des journalistes a été délibérément entravé et empêché par des organisateurs de la manifestation. Bien qu’étant en infraction totale avec l’article 14 du décret-loi, aucun des agresseurs n’a encore été poursuivi », constate Reporters sans frontières dans un rapport récent sur la Tunisie.

De son côté la Fédération internationale des journalistes (FIJ) a dénoncé le silence assourdissant des dirigeants du parti islamiste.
Malgré la prédominance féminine dans le secteur, et en particulier sur le terrain, l’accès des femmes journalistes aux postes de direction dans les médias tunisiens, qu’ils soient publics ou privés, ne dépasse pas les 11 %.