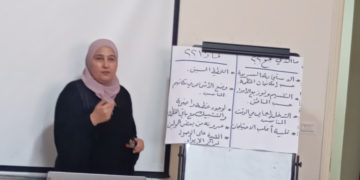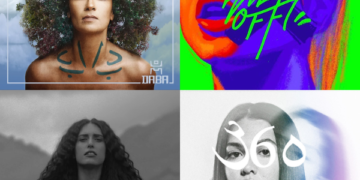Faut que je te dise, pour une éducation féministe à grande échelle [en 10 langues]
Est-ce que les filles sont vraiment nulles en maths ? Est-ce qu’avorter peut me rendre stérile ? Pourquoi c'est important de mettre de l'argent de côté ? Faut que je te dise entend fournir des réponses à des questions que les jeunes filles peuvent se poser afin de « les aider à faire des choix éclairés ». Un peu plus discret qu'un livre, ce podcast a été pensé comme un véritable outil d'éducation. « En ligne, sur les questions intimes des adolescentes, on trouve tout et son contraire. Or savoir le plus tôt possible que le viol c’est grave, que l’avortement ne rend pas stérile, ou qu’il existe des moyens pour faire l’amour sans tomber enceinte, ça peut changer une vie de femme », explique au magazine Télérama Charlotte Pudlowski du studio Louie Media, qui a co-produit ce podcast avec le média Elle. L'ambition est de toucher un large public, car les épisodes sont disponibles en dix langues, grâce à l'intelligence artificielle. Une expérimentation menée avec rigueur, toutes les traductions ont été vérifiées par des professionnel.le.s.
Les vingt épisodes durent moins d'une dizaine de minutes chacun. Pas d'habillage sonore, il n'y a que la voix de la journaliste française Marine Revol qui nous parle et qui reste identique selon les versions puisque celle-ci a été clonée. Le ton n'est pas donneur de leçons, les propos sont fouillés et s'appuient en grande partie sur des études. Marine Revol ne s'interdit pas non plus de dire « je » de temps en temps, un peu comme une grande sœur qui partagerait son expérience. Reste à savoir si un contenu similaire, quand il relève des questions intimes, peut toucher des auditrices vivant dans des contextes socio-culturels aussi différents. Sur ce point, Charlotte Pudlowski répond : « Les gens savent d’où elle parle. Mais bien sûr le biais culturel existe, on ne peut pas le nier. Néanmoins, on a tout fait pour que le podcast parle à tout le monde : les exemples issus de la pop culture sont ainsi aussi divers que possible. »
De eso no se habla - Épisode 3 « Une plaque dans ma ville » / Parce que les silences en disent long (en espagnol ST anglais)
Dans le troisième épisode de la première saison de De eso no se habla (De cela nous ne parlons pas), Isabel Cadenas nous emmène dans sa ville natale, Basauri, à une dizaine de kilomètres de Bilbao en Espagne. Un événement historique s'y est produit il y a plusieurs décennies et la journaliste n'en avait jamais entendu parlé. Et pour cause, les protagonistes de cette histoire se sont retirés dans le silence, si bien que certains ignorent même en avoir fait partie ! Il est question du procès de 10 femmes, arrêtées et jugées pour avoir eu l'intention ou pour avoir réellement avorté, en 1976. Un homme a également comparu pour avoir incité une femme à interrompre sa grossesse, d'où le nom de la campagne Basauri 11. Car cette affaire a déclenché une vaste mobilisation des femmes de l'ensemble du pays, réclamant leur acquittement et le droit à l'avortement. Le début d'une longue bataille, alors médiatisée, qui a conduit à la dépénalisation de cet acte médical en 1985. Une plaque commémorative a été installée à Basauri, sans que beaucoup d'habitant.es ou les concernées ne connaissent son existence, ni même l'histoire qui se cache derrière.
Qu'est-ce que cet oubli collectif raconte de notre société ? C'est ce qui intéresse Isabel Cadenas. Le podcast De eso no se habla investigue les trous de notre mémoire à travers des récits intimes, singuliers pour jeter une lumière nouvelle sur l'Histoire de l'Espagne, ternie par quarante ans de dictature. Cela passe par sortir de l'ombre les non-dits, exposer les tabous, faire entendre les voix tues. Le tout grâce à un travail sonore d'une grande qualité et à travers une voix chaleureuse.
Même si la parole leur est donnée dans les trois premiers épisodes de la saison 1, les femmes ne sont pas les seules à s'exprimer dans De eso no se habla et les histoires sont diversifiées. Avec « Une plaque dans ma ville », Isabel Cadenas nous offre un récit inédit, qui ne peut que surprendre, interroger, que l'on soit espagnol.e ou non, tant il résonne par-delà les frontières.
Retrieved, a feminist foreign policy podcast series, penser le féminisme à un autre niveau (en anglais avec transcription)
Produit par la fondation allemande Heinrich Böll Stiftung de Thessalonique, en Grèce, le podcast Retrieved (Retrouver), donne des clés pour comprendre ce qu’est une politique étrangère féministe, ce que cela recouvre et implique, en cinq épisodes de trente minutes. L'objectif de cette série est résumé de cette manière : « Féministe et patriarcat sont des termes que l'on retrouve souvent dans les discussions concernant l'organisation interne des sociétés. Pourtant la politique étrangère est fortement influencée par les structures et les préjugés patriarcaux et elle peut être meilleure. » Le premier épisode « Why feminist foreign policy ? Pourquoi une politique étrangère féministe ? » donne un aperçu général.
Les questions posées par les deux journalistes, Christina Piliouni et Georges Miaris à Nina Bernarding, co-fondatrice du Centre pour une politique étrangère féministe (CFFP) à Berlin en Allemagne, sont pertinentes et fournissent quelques éléments de réponses à des interrogations qu'une personne non familière du sujet ou sceptique pourrait avoir : Sur quelles valeurs fondamentales reposent une politique étrangère féministe ? Les pays peuvent-ils mettre en œuvre une politique étrangère féministe s'ils n'ont pas encore atteint un certain degré d'égalité dans leur politique intérieure ? Et encore : en quoi une politique étrangère féministe peut-être bénéfique pour l'ensemble de la population ?
Les épisodes suivants zooment sur des politiques étrangères spécifiques : le commerce d'armes, les politiques migratoires, les processus de paix dans les zones de conflits. Les invité.e.s sont des expert.e.s internationaux/les, possédant une longue expérience dans le domaine. Ils/elles se réfèrent à plusieurs conclusions d'études internationales pour mettre en avant la pertinence des politiques étrangères féministes. Celles-ci mériteraient d'être plus rigoureusement citées, néanmoins elles sont éclairantes. Maria Hadjipavlou, chercheuse chypriote et activiste, rapporte par exemple qu'une étude de l'Institut international pour la paix a analysé plus d'une centaine d'accords de paix signés entre 1989 et 2011 et il a été révélé que lorsque les femmes sont incluses dans les processus de paix, il y a 35% de probabilité en plus que la paix dure 15 ans ou davantage.
Tous les épisodes sont à retrouver ici. D'autres branches de la fondation Heinrich Böll Stiftung ailleurs dans le monde ont aussi lancé des podcasts sur ce thème, à Washington et à New Delhi, permettant d'élargir la réflexion.
Aux origines du podcast féministe en France
En 2017, à l'occasion de ses 15 ans, la plateforme Arte radio, à l'avant-garde de l'émergence du podcast en France, réunissait quelques-unes des créatrices pionnières de contenus féministes de l'hexagone pour un débat intitulé : « Le podcast, nouvel eldorado féministe ? ». Une ambition serait à l'origine de nombreuses productions : faire entendre la voix de toutes les femmes, souvent à travers une approche intersectionnelle. La journaliste Lauren Bastide justifie ainsi l'existence de (La Poudre) : « Le besoin de créer un espace de parole exclusivement féminin. […] L'envie est partie du constat de l'absence de la parole des femmes dans la société en générale et dans les médias en particulier. […] Quand une femme parle, elle est interrompue, on détourne toujours l'attention sur son apparence. »
Parmi les invitées, plusieurs professionnelles sont passées par les rédactions de grands médias et y ont vécu le sexisme, avant de choisir de se lancer dans l'aventure du podcast. Victoire Tuaillon (Les couilles sur la table) témoigne : « Je me souviens d'un été à France 2 à vouloir faire un sujet sur le harcèlement de rue. Tous mes chefs me disaient, "ça n'existe pas." »
Les créatrices de podcast sont devenues aussi réputées que leurs émissions numériques. Elles disent « je » et n'hésitent pas à partager leurs propres expériences. Certains podcasts reposent entièrement sur la voix de celles qui l'animent. « Quand on écoute un podcast régulièrement, on crée un lien avec la personne. C'est un lien intime, on l'écoute en allant dans le métro. C'est un peu comme un livre », observe Mélanie Wanga (Quoi de meuf). « Les femmes se rendent compte qu'elles ne sont plus toutes seules. », abonde Adama Anotho, une des productrices d'Exhale, à destination des femmes noires francophones. Les podcasts permettent ainsi de faire émerger des voix individuelles fortes, auxquelles les auditrices, grâce à des expériences communes, peuvent s'identifier, voire les prendre pour modèles.