Le séisme du 8 septembre 2023 a laissé du jour au lendemain, des milliers de personnes sans abri, des enfants orphelins et des femmes livrées à elles même. Dans les régions d’Al Haouz, Chichaoua, Taroudant et Azilal, situées entre Marrakech et Agadir, le bilan est estimé à 2.947 morts et 5.679 blessés. Une enveloppe globale de plus de 1 milliard de dirhams a été allouée à la reconstruction et la mise à niveau des logements effondrés totalement ou partiellement lors du séisme.
Malgré ces efforts, ce drame résonne aujourd’hui encore comme un réveil brutal, rappelant les inégalités profondes d’un monde rural oublié.
A travers le pays, la mobilisation a été générale. Des réponses humanitaires ont émané de toutes les villes où se sont activées société civile, associations et ONG, etc. Des fonds spéciaux dédiés à la gestion des effets du tremblement de terre ont été mis en place par l’état, ainsi que des aides d’urgence mensuels aux ménages qui avaient tout perdu. Des programmes de reconstruction de logements ont été lancés, mobilisant plusieurs équipes techniques sur le terrain (architectes, topographes etc.) déployées dans les communes les plus touchées. 42.047 autorisation de reconstruction ont été ainsi accordées, et 8.694 maisons endommagées sont actuellement en reconstruction ou en restructuration.
« Les villages sinistrés se sont vite transformés en entrepôts » décrit Nour-Salka Belkebir, une jeune étudiante, membre de l’association Aider sans limite à Rabat. Alimentation, habits, tentes... l’abondance des dons a duré tout au long des premiers mois, avec l’appui de la fondation Mohammed V qui a géré la distribution sur place. « Nous avons fait un grand travail de tris, en coordonnant avec les associations locales pour mieux répondre aux besoins des populations et n’envoyer que ce qui est nécessaire » explique-t-elle.
Cependant, les conditions sur place ont tourné au calvaire à l’arrivée de l’hiver, en novembre. Les tentes, ayant jusque-là fait office d’abris, ne protégeaient ni du vent, ni de la pluie, encore moins du froid. « Les habitants des villages ont dormi dans les maisons qui avaient quelque peu résisté au séisme. Ils ont bricolé aussi pour rendre les tentes étanches avec les moyens du bord ». Aujourd’hui, des maisons mobiles temporaires stables et solides ont été installées dans la plupart des villages. Certains programmes de reconstruction commencent aussi à voir le jour (comme à Ouirgane où 200 maisons en terre ont été construites). En outre, 51.300 familles auraient bénéficié d'une première aide financière de 20.000 dhirams par foyer.
Toutefois, au fil des mois, les dons ont fini par s’amenuiser et le drame de ces régions est vite retombé dans l’oubli. « Aujourd’hui, les femmes et les enfants sont au cœur des besoins signalés par les associations locales » souligne Nour.

Pourquoi les femmes sont-elles plus vulnérables face à la tragédie ?
« Il nous a fallu du temps pour penser aux femmes et à leurs besoins spécifiques » avoue la jeune bénévole Nour.
Les premiers convois répondaient aux besoins basiques : s’abriter, s’alimenter et s’habiller, indépendamment du facteur genre. Cette neutralité reste pourtant en défaveur des femmes. Ainsi, Nour raconte que les premiers dons privilégiaient des vêtements masculins, les organisateurs considérant que ceux-ci pouvaient être portés par les femmes, tandis que l’inverse ne serait pas envisageable. « Il y a aussi les produits d’hygiène et les protections menstruels, qui sont indispensables, auxquels les donateurs ne pensent pas du tout », ajoute-t-elle.
Dans les situations de crise, la grande difficulté rencontrée par les femmes est d’assurer leur besoin d’intimité. Sans abri, il est difficile de trouver un espace personnel et sécurisé, pour se changer par exemple, durant la période de menstruation. D’autant plus que dans ces régions conservatrices, les femmes ont une grande pudeur et ne sont pas habituées à la mixité. « Nous avons installé des tentes pour hommes, et d’autres pour femmes. C’est important d’assurer à ces dernières un espace à soi », affirme Nour.
Par ailleurs, l’arrivée en masse des aides et des bénévoles citadins dès les premiers jours après le séisme est aussi louable qu’intrusive. Les conditions post-tragédie favorisent aussi l’augmentation des risques de violences sexistes. Ainsi, sur les réseaux sociaux, de nombreux messages relayés incitaient les Marocains à épouser des jeunes filles mineures issues des villages sinistrés pour les « sauver », ou de les embaucher comme « bonne ».
La vulnérabilité est donc une porte ouverte aux prédateurs et aux opportunistes. Depuis, plusieurs féministes marocaines ont lancé des appels à vigilance dans les douars, en disposant des formatrices sur place pour sensibiliser les jeunes filles et les enfants à ce sujet.

Associations, coopératives : Les femmes s’entraident pour se relever
D’un village à un autre, les conditions des femmes diffèrent. Si dans certaines régions les femmes sont actives, dans d’autres, elles sont moins mises en avant. Taddart est un des villages les plus pauvres et les plus enclavés de la province de Chichaoua, également frappée par le séisme.
« Une femme ici ne vaut rien », déclare une dame de Taddart, avec une simplicité déchirante. Ses mots ont résonné comme un appel à l’action » confie Souad Dibi, présidente fondatrice et actuellement directrice de l’association El Khir. Basée à Essaouira, l’association El Khir œuvre pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Depuis le séisme, l’association oriente ses actions vers les femmes issues des régions touchées par le séisme.
« Nous avons mis en place un centre d’écoute mobile pour offrir un soutien psychologique et un suivi post-traumatique » explique Souad. En plus du soutien psychologique, l’association El Khir a pris en charge plusieurs femmes en difficulté juridique. Enfin, dans l’optique d’aider les femmes à générer une entrée d’argent et à améliorer leur condition, plusieurs sessions d’apprentissage ont été proposées aux femmes du village, pour les former à la broderie et aux métiers artisanaux, et ce en vue de créer une coopérative.
« Nous avons installé des métiers à tisser dans le village [...]. Bien qu’étant une tragédie, le séisme a allumé malgré tout une flamme d’espoir pour un changement significatif. » souligne Souad Dibi.
Dans d’autres régions, les femmes se sont organisées elles-mêmes en créant un projet collectif. C’est le cas du Douar Ait Ouabdi, dans la province de Taroudant, où elles ont créé ensemble un club dédié à la production et à la commercialisation de l’huile d’Argan. Réunies sous une tente, elles se sont remises au travail pour se relever, guérir ensemble et aspirer à de nouveaux lendemains.













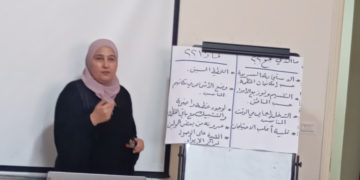



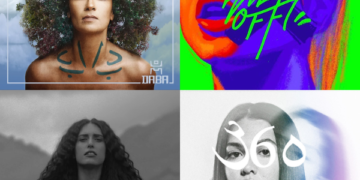








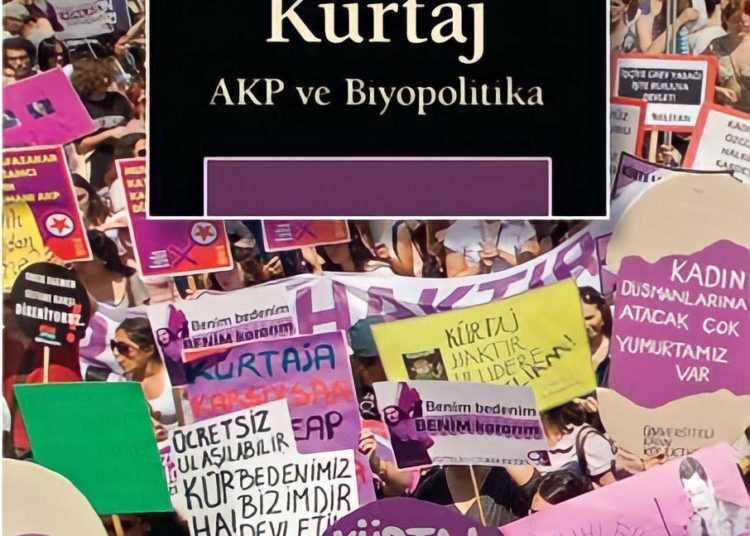




Bravo pour cette mide en lumiere