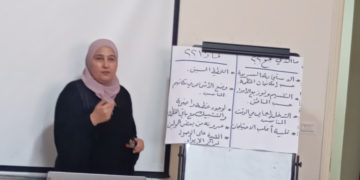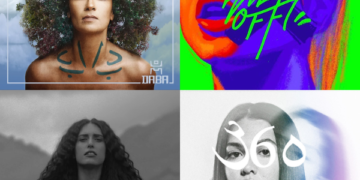Cette publication est également disponible en : VO
« Savoir être solitaire est essentiel à l’art d’aimer. Lorsque nous sommes capables d’être seul.e.s, nous pouvons être avec les autres sans les utiliser comme une échappatoire » (1). La phrase de l’écrivaine et philosophe Bell Hooks synthétise de manière fulgurante une vérité profonde que notre époque technologique et liquide fuit obstinément.
La raison en est simple : nous avons construit le virtuel, vulgaire et tapageur, de la « nuée » - c’est en ces termes que le philosophe Byung Chul Han définit l’humanité du réseau dans son essai Dans la nuée : réflexions sur le numérique (2) - en le qualifiant de « sociabilité » et en déclarant qu’il est l’antidote à la solitude, quitte à ne plus savoir quoi faire de nous-mêmes une fois nos appareils éteints.
Notre époque est celle de l’horreur du vide et de l’absence, elle considère la solitude comme un ennemi à combattre, en ignorant le fait qu’apprendre à être seul.e.s est une condition humaine indispensable pour construire notre pensée, les conceptions et les choix de vie qui donnent du sens à l’être au monde.
Ne pas être capable de solitude, c’est ne pas être capable de développer son autonomie, son sens critique, sa responsabilité. Je serais peut-être plus seule, sans ma solitude, écrivait Emily Dickinson, tandis qu’en 1929, Virginia Woolf publiait le célèbre essai Une chambre à soi (A Room of One’s Own) : le titre vient de l’idée de Virginia Woolf selon laquelle « il est indispensable qu’une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire ». Une chambre à elle et rien qu’à elle, pour être seule au moment de la création et de la réflexion.

Nous appelons « drame de la solitude » les morts rapportées par les faits divers : il serait plus juste d’employer l’expression de « drame du lien social », parce que c’est la collectivité dépourvue du souci des autres qui tue, beaucoup plus que la solitude. Nous avons qualifié de « sociaux » les réseaux auxquels nous déléguons la construction de nos relations, qu’elles soient intimes ou politiques, décorant de façon magistrale ces cathédrales de l’individualisme. Or, nous sommes parfaitement seul.e.s au milieu des autres lorsque nous sommes sur nos téléphones, tête baissée, et nous appelons ça « le social ».
Or pour plusieurs raisons, les familles sont de plus en plus composées d’hommes et de femmes seul.e.s, en Italie du moins.
« La diminution du nombre de ménages familiaux dérive des conséquences de longue durée des dynamiques socio-démographiques à l’œuvre en Italie : le vieillissement de la population, ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie, entraîne en effet une élévation du nombre de personnes seules ; la baisse prolongée de la natalité accroît le nombre de personnes sans enfants, tandis que la hausse de l’instabilité conjugale, due à un plus grand nombre de dissolution des liens de couple, entraîne une augmentation du nombre d’individus et de parents seuls. »
Telles sont les conclusions de l’Istat, l’Institut national de statistique italien, dans son rapport sur les nouvelles prévisions relatives à l’avenir démographique du pays, mises à jour en 2021. C’est aux personnes seules, associées tout de même au concept de famille, bien que « micro », que l’on doit pour l’essentiel l’augmentation absolue du nombre total de familles. Les hommes qui vivent seuls – explique l’Istat – augmenteront de 18,4%, jusqu’à dépasser les quatre millions en 2041. Le nombre de femmes seules serait destiné à à augmenter encore plus, de 4,9 à presque 6 millions, avec une croissance de 22,4%.
S’il est vrai que pour apprendre à construire des relations avec l’autre, il faut d’abord savoir qui l’on est et ce que l’on veut, et si cet apprentissage requiert une prise de conscience qui passe par un cheminement solitaire, à quel moment appliquons-nous cette vérité étroitement liée au développement et à la maturité ?
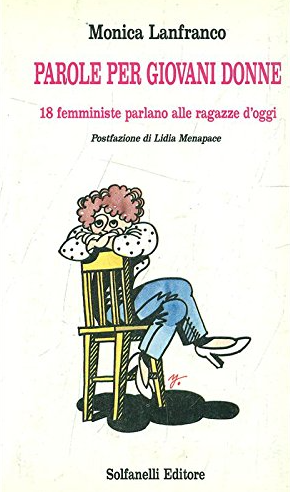 Ma réflexion sur la solitude comme ressource aussi bien individuelle que politique a commencé tôt, et elle s’est connectée au féminisme de manière évidente en 1981, quand j’ai présenté mon premier livre à Vérone Parole per giovani donne – 18 femministe parlano alle ragazze d’oggi [Des mots pour les jeunes femmes – 18 féministes parlent aux filles d’aujourd’hui, non traduit en français]. J’avais trente ans et j’étais mère de mon premier enfant depuis peu. Une jeune femme intervint, et me dit : « Je vous remercie pour votre livre et pour votre engagement féministe. Le travail politique des femmes plus âgées nous a permis, à moi et aux filles de ma génération, d’avoir des libertés et des possibilités que vous n’aviez pas. Mais il y a un problème : être consciente en tant que femme fait de moi, aujourd’hui, à mon époque, quelqu’un de différent du reste de ma génération. Avec les garçons de mon âge, je ne sais pas quoi dire ni quoi faire, ils sont tellement peu intéressants, tellement loin de moi que pour trouver un homme avec lequel je pourrais avoir une relation je dois chercher du côté des hommes plus âgés, ce qui génère d’autres types de problèmes. Avec les filles de mon âge, j’ai l’impression d’être une extra-terrestre : elles, elles s’intéressent à l’apparence extérieure, aux mannequins de la télé, à un avenir avec mari et enfants. Du coup, je suis seule, je me sens seule. En tant que féministe, je suis une jeune femme seule. Le féminisme m’a rendue seule. »
Ma réflexion sur la solitude comme ressource aussi bien individuelle que politique a commencé tôt, et elle s’est connectée au féminisme de manière évidente en 1981, quand j’ai présenté mon premier livre à Vérone Parole per giovani donne – 18 femministe parlano alle ragazze d’oggi [Des mots pour les jeunes femmes – 18 féministes parlent aux filles d’aujourd’hui, non traduit en français]. J’avais trente ans et j’étais mère de mon premier enfant depuis peu. Une jeune femme intervint, et me dit : « Je vous remercie pour votre livre et pour votre engagement féministe. Le travail politique des femmes plus âgées nous a permis, à moi et aux filles de ma génération, d’avoir des libertés et des possibilités que vous n’aviez pas. Mais il y a un problème : être consciente en tant que femme fait de moi, aujourd’hui, à mon époque, quelqu’un de différent du reste de ma génération. Avec les garçons de mon âge, je ne sais pas quoi dire ni quoi faire, ils sont tellement peu intéressants, tellement loin de moi que pour trouver un homme avec lequel je pourrais avoir une relation je dois chercher du côté des hommes plus âgés, ce qui génère d’autres types de problèmes. Avec les filles de mon âge, j’ai l’impression d’être une extra-terrestre : elles, elles s’intéressent à l’apparence extérieure, aux mannequins de la télé, à un avenir avec mari et enfants. Du coup, je suis seule, je me sens seule. En tant que féministe, je suis une jeune femme seule. Le féminisme m’a rendue seule. »
Ce « seule » répété de si nombreuses fois a continué à résonner dans mon esprit et m’a accompagnée depuis lors, trace d’une arrière-pensée constante, inquiétante.
La vérité rend libre, et la conscience de soi est un bénéfice précieux et extraordinaire : c’est là une affirmation à forte valeur éthique, un aiguillon prodigieux. Mais il est nécessaire d’expliquer aux générations futures que la liberté libérée par la conscience de soi a des coûts et un prix. Celui, par exemple, de te séparer de la protection caressante, reposante et adhésive du troupeau, du clan, des rôles et de la prison préconçus et assignés à ton sexe. Celui de te faire sortir de la protection garantie aux femmes qui ne se rebellent pas, qui se font les porteuses obéissantes des valeurs de la tradition. On oublie de dire, ou on tait consciemment, que la liberté des femmes est dérangeante, inattendue et mal vue, pour des raisons différentes, à la fois par les hommes et par les femmes elles-mêmes. Qu’elle est toujours combattue et ennemi du succès et de la cohabitation avec le pouvoir – sauf s’il s’agit d’une liberté cédée par cooptation, pour un contrat à durée déterminée et subordonné aux règles à respecter dans les lieux et dans les rôles qui comptent, sans jamais les mettre en question.
Ne pas être capable de solitude, c’est ne pas être capable de développer son autonomie, son sens critique, sa responsabilité.
La jeune femme de Vérone faisait l’expérience de ce que la sortie des règles et du “destin” qui lui était assigné en tant que femelle dans l’espèce humaine avait un prix élevé, auquel elle avait donné le nom de « solitude ». Le prix de l’autorité et de la conscience de soi comme sujet, et non comme simple femelle dans l’espèce humaine était la solitude.
Un prix élevé, certes : mais il est bien plus cruel, destructeur et dangereux d’apprendre aux plus jeunes que la solitude est une condition à fuir à tout prix. Au contraire, ce n’est qu’en étant bien seules que nous serons capables, après avoir pris nos mesures, de construire des relations saines, parce qu’elles ne seront ni symbiotiques, ni dépendantes.