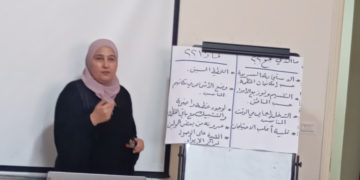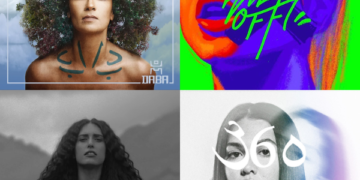Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)
Hedia Baraket














Image Zéro : Un tableau de maître Novembre 2023
Début de l’opération terrestre israélienne à Gaza. Un banc d’hôpital. Une jeune femme, visage lunaire, mère de quatre enfants, assis qui sur son giron qui à ses côtés. Une couche épaisse de poussière les enveloppe de la tête aux pieds du même drap blanc. Sur la tempe de la mère, un filet de sang gluant serpente sur un chemin de poussière aussi loin qu’il peut jusqu’à se coaguler au bas de la joue. Pas de cris, ni de pleurs. Juste une surprise dans les yeux des enfants et un vide mystérieux dans ceux de la mère… Accompagnée d’une chanson qui dit : « Salam ya Gazza », « Salut Gaza » ou « Paix sur Gaza », la vidéo est d’une douleur, d’une douceur, d’une tendresse, d’un esthétisme, d’une poésie et d’un romantisme qu’on ne verra plus beaucoup après. A l’approche de la caméra, la femme fixe le photographe dans les yeux, ne change rien à son expression, ne dit rien mais lui expose ses enfants un à un avec des gestes lents et affectueux. Toujours dans le silence.
Ce tableau de maître ne porte aucune signature mais date des toutes premières blessures de Gaza. Gaza la femme, l’amour, la paix, la famille, la patience, la résistance au blocus, la résilience, la dignité, l’incrédulité et encore et surtout l’espoir que cela n’est qu’un cauchemar… Mais ceci n’est pas un cauchemar. Tout est réel. Tout s’est emballé si vite, si fort. Au rythme des frappes déchaînées, des ciblages indiscriminés, des massacres de civils, du nombre de cadavres d’enfants. A ce même rythme, un film des horreurs s’est enclenché viscéral, instinctif, intimiste, sans scénariste, sans réalisateur, sans acteurs autres que les gazaoui.e.s sinistré.e.s, sans cameramen autres que les journalistes et les blogueurs locaux, que la masse ordinaire des smartphonistes.

Résultat : des images inondent aussitôt la toile, une onde de choc s’empare des réseaux. Les images tombent aussi brusquement que les missiles, que les immeubles qui s’effondrent, elles courent aussi vite que le feu, que les ambulances, que les brancardiers, que les taches de sang qui se propagent sur les draps des blessés. Mais pourquoi tant d’images ? Une question qu’on n’a même pas le temps de poser devant deux ou trois faits : l’effet surprise, la rapidité des frappes et la nature et l’étendue des atrocités. Avec un peu de recul, quelques réponses :
Elles offrent les cadavres de leurs enfants aux objectifs tel des trophées
Le jeune homme court, essoufflé. La couverture sur les bras traîne par terre. Elle cache à peine le corps d’un enfant dont les bras et les jambes pendent à découvert. La localisation de la tâche de sang vermeil sur la couverture bleu ciel montre que la blessure touche le haut du corps : poitrine, cou, ou même partie de la tête. Mais dans sa course folle, le jeune père s’arrête, halète : « Sawwer ! Sawwer ! Khalli el 3alam ychouf ahdaf Netanyahu !!! » « Filmez ! filmez ! Laisser le monde voir les cibles de Netanyahu !!! » Le shooting fini, il reprend sa course vers l’ambulance à l’autre bout de la rue, là où l’accès est fermé. On ne sait si l’enfant est vivant.

Et puis il y a tous les autres, les dizaines de milliers d’autres femmes et hommes qui arborent, tel des trophées, leurs enfants difformes, ramollis tels des pantins, décapités, en criant : « Filmez ! filmez ! Voilà les objectifs stratégiques de Netanyahu ! » Des milliers d’images, de vidéos semblables véhiculent le même message fort de mères, pères, médecins, secouristes, parents, voisins qui dans leur détresse, leur course contre la mort livrent les corps ou les cadavres de leurs proches aux objectifs.
Avec toute la vénération qu’ils portent à l’humain mort ou vivant, ils se départissent dans un moment de pragmatisme ou de nécessité extrême, de ce « respect », tombent les couvertures, dévoilent les amputations, découvrent les tripes, les peaux scalpées, les corps déchiquetés, les morceaux de chair. Ils demandent de les filmer et rien d’autre que de les filmer. Dès lors quel journaliste, quel passant muni d’un simple smartphone peut-il rester sourd à une sollicitation qui sonne comme un SOS. C’est à peine s’ils floutent l’insoutenable. C’est à peine s’ils s’accrochent à l’expression minimale d’une éthique professionnelle revue et corrigée, à l’épreuve de la réalité. En d’autres temps, pas si lointains, filmer et partager des photos d’enfants relevait en soi de la faute déontologique. Mais Gaza a érigé ses propres règles d’un journalisme citoyen improvisé, organisé dans la précipitation, mais respectueux de la vie et croyant au pouvoir absolu de l’information. Gaza est peut-être le premier champ de guerre de l’histoire du monde à être ainsi offert aux libres objectifs sans visites guidées, ni cordons de sécurité. Les horreurs perpétrées ne souffrent point la censure, ni le tri. A peine le floutage des décapités et des tripes à l’air.
Ces femmes qui n’arborent pas de drapeaux blancs ni ne quittent leurs régions durant le pire des sièges, des tirs de chars et des blocus alimentaires. Ces réfugiées qui font de leurs tentes de fortune, des espaces de vie, de scolarité, de thérapie, de jeux, de chants, de danse, de joie, d’amour, de résilience et de nouvelles naissances… Comme actes de résistance.
Confiant.e.s, on se livre à des caméras amies
Les journalistes, les blogueur.e.s, les citoyen.n.e.s qui se sont investi.e.s de cette mission de filmer et de ne rien rater sont exclusivement des Gazaoui.e.s, des locaux qui ont spontanément comblé le vide abyssal crée par Israël avec la fermeture des frontières et l’interdiction de toute autorisation d’entrée aux correspondant.e.s de guerre étrangers. Ils et elles ont cette connaissance du terrain, des mœurs, des tempéraments, des habitudes, de la géographie, de l’histoire, et ont aussi cette facilité d’approche. En face, les témoins ont cette confiance, cette proximité, ce lien qu’aucun correspondant étranger n’aurait pu leur procurer. D’où l’intimisme, la véracité, l’authenticité, voire la brutalité des vidéos sans arrangements, sans mise en scène. A Gaza, un nouveau journalisme est né : le journalisme citoyen incarné dans sa plus profonde signification. L’histoire en live, sans fard, qui laisse libre cours aux émotions.
« Nous ne sommes pas des chiffres ». « Racontez notre histoire ». « Celui qui survivra racontera ». « Partagez, partagez, partagez !!! » Des mots d’ordre d’intellectuels, de poètes, d’enseignants, d’écrivains donnent le ton. Ils sont religieusement appliqués. D’autant que leurs auteur.e.s ont gagné l’au-delà et que leurs consignes se chargent de sacralité. Les internautes assurent la relève. Des slogans, des hashtags inondent la toile.
« We will not forget », « Nous n’oublierons jamais », « We will not be free until Palestine will be free », « Nous ne serons pas libres tant que la Palestine ne le sera pas » … L’histoire de la Palestine est faite de massacres, de carnages, de génocides, d’usurpation de propriétés, de vols de terres, de déplacements forcés, d’exodes, de sang et de larmes. Autant de pages tournées. De 1917 à 2023, peu d’images le montrent. L’oubli est de mise. La résilience est la clé de la résistance.
Gaza 2023/24/25 a ceci de différent : l’ampleur des massacres, l’abondance des armes, la longévité de la guerre, le bilan des carnages, les critères de génocide qu’ont vite pris les attaques. Autant de raisons de combler un vide d’images, de combattre un déni, de détruire des mensonges.
Mais s’il n’y avait aujourd’hui qu’une image à retenir du génocide de Gaza, laquelle choisir ? La plus sanguinolente ? La plus insoutenable ? Où la trier ? Parmi les plus virales ? Dans quelle catégorie « ordinaire » la chercher ? Du côté des enfants ? Des femmes ? Des hommes ? Des héros ordinaires ? Des héroïnes et des héros hors du commun que le système « Lavender » de l’intelligence artificielle a répertoriés et éliminés pour priver Gaza de leur valeur ?
Il n’y a pas une seule image emblématique de Gaza
L’Histoire abonde de révolutions sanglantes, de guerres et de crimes de guerre, de massacres de minorités, de génocides, d’épurations ethniques. Peu ont connu la densité iconographique, l’instantanéité, la force et la viralité des images de Gaza.
8 juin 1972. Kim, la petite vietnamienne de 9 ans brûlée au Napalm, court nue dans la rue, le dos en flammes. La photo prise sur le vif par un jeune photographe d’Associated Press fera basculer l’opinion américaine en pleine guerre du Vietnam.
5 juin 1989, un homme anonyme nommé plus tard Tank man se tient désarmé arrêtant seul une colonne de chars de l’armée chinoise sur la place Tian’anman. Saisie par un photographe américain, la photo sera un symbole de la résistance à la répression… Bien d’autres photos en noir et blanc ou en sépia marquent encore les esprits d’un temps où les guerres et les révolutions pouvaient être résumées en une image faisant la une des journaux et, plus tard, illustrant les analyses des livres d’histoire.
Mais s’il n’y avait aujourd’hui qu’une image à retenir du génocide de Gaza, laquelle choisir ? La plus sanguinolente ? La plus insoutenable ? Où la trier ? Parmi les plus virales ? Dans quelle catégorie « ordinaire » la chercher ? Du côté des enfants ? Des femmes ? Des hommes ? Des héros ordinaires ? Des héroïnes et des héros hors du commun que le système « Lavender » de l’intelligence artificielle a répertoriés et éliminés pour priver Gaza de leur valeur ? Du côté de l’espoir ? De la résilience ? Du tragique absolu ? De l’atrocité ? De l’ignominie ? Des résistants armés aux pieds nus ? Des rires obscènes de soldats israéliens explosant des maisons et tuant des enfants ? Des fosses communes ? Des charniers ? Des enterré.e.s vivant.e.s ? Des brûlé.e.s vifs/ves ? Des foules affamées brandissant des casseroles vides ? Des queues assoiffées attendant leur droit à un bidon jaune ? Des populations massacrées pour un kilo de farine qui a bu leur sang avant de les nourrir ? Des sols d’hôpitaux jonchés de blessé.e.s graves que les médecins ont le devoir de trier pour en sauver quelques-un.e.s ? Des journalistes jetant leurs casques et leurs gilets au feu parce qu’ils n’ont pas servi à les protéger contre une liquidation programmée pour un génocide à huis clos ? Des maisons et des tentes croulant sous des bombes faites pour abattre des montagnes ? Des champs de blé et des oliveraies brûlés au phosphore blanc pour ne plus rien produire ? Des puits d’eau empoisonnés ?... Des ambulances brûlées ? Des hôpitaux détruits ? Des kilomètres de villes et de quartiers rasés ? Des otages dénudé.e.s et enchaînées, conduit.e.s vers les bagnes de la torture ? Des populations déplacées de force, courant avec enfants, matelas, balluchons et bombardées en cours de route ? Des familles réfugiées dans des écoles prises pour cible pour chiffrer les carnages ? Des familles au complet exterminées dans leur sommeil ? Des blessé.e.s laissé.e.s pour mort.e.s privé.e.s de soins, interdit.e.s de sépulture et d’enterrement, livré.e.s aux chats et aux chiens ? Des enfants qui tremblent de tous leurs membres du fait d’un syndrome encore inexploré ? Des bébés qui s’éteignent sans une égratignure parce qu’un gaz inodore et incolore étouffe leur souffle « en douceur » ?... Des manifestations du bout du monde portant, sous la pluie et la neige des poupées ensevelies dans des linceuls blanc maculés de sang ? Des larmes des passant.e.s de villes lointaines qui n’avaient encore jamais entendu parler d’une bande nommée Gaza. Des flash mob, des chorégraphies, des spectacles de rue exprimant la barbarie dans son décor le plus choquant ? Des expressions artistiques, des peintures, des caricatures, des concerts d’artistes de renom, des conférences de libres penseur.e.s mettant à nu la vérité historique d’un mensonge nommé Israël… Il semble donc qu’il n’y ait point de raccourci emblématique qui puisse porter seul la charge symbolique du génocide de Gaza. Des millions d’images regorgent de millions de symboles. Néanmoins quelques exemples concourent, empreints de vérité, force, émotions.

Ces femmes debout qui gardent pieds et racines sur les tas des décombres
Ces vidéos des aurores grises où les torches des secouristes éclairent des corps, des têtes ou des membres sous les décombres ? Et ces cris d’espoir qui fusent, qui jurent : « Aycha ! Wallah Aycha ! Fiha nafass ! fiha nafass ! » « Elle vit, je vous jure qu’elle vit ! Il y a du souffle en elle ! Il y a du souffle en elle ! ». Ces hommes courant vers les hôpitaux, portant précieusement des cadavres inidentifiables, des sacs de chairs anonymes et d’organes dont on ne sait plus à qui ils ont appartenus ? « Achlaa ! achlaa ! » « Des fragments ! Des fragments ! », répètent-ils, hagards. « On devra les remettre bout à bout grâce aux couleurs de leurs vêtements ! ». Cette charrette tirée par une jument fatiguée, chargée de corps entrelacés, de membres pantelants bercés au rythme du trot de la bête. Près d’une dizaine si l’on compte les têtes… La plupart sont vivants. Ils et elles seraient sauvé.e.s si seulement l’hôpital le plus proche disposait des soins nécessaires.
Ces tableaux apocalyptiques d’exodes massives, de vagues humaines grises affluant sur les décombres en postures animales, vues d’en haut. Est-ce cela l’image de la déshumanisation programmée ? Mais il semble que la déshumanisation n’est qu’un mot d’ordre qui ne tient pas longtemps devant d’autres tableaux où l’on voit ces femmes debout qui gardent pieds et racines sur les tas des décombres, ancrage au plus fort des souffles et des éclats de bombes. Ces femmes qui n’arborent pas de drapeaux blancs ni ne quittent leurs régions durant le pire des sièges, des tirs de chars et des blocus alimentaires. Ces réfugiées qui font de leurs tentes de fortune, des espaces de vie, de scolarité, de thérapie, de jeux, de chants, de danse, de joie, d’amour, de résilience et de nouvelles naissances… Comme actes de résistance.
On entend ces femmes démunies et désarmées qui jurent de rester sur leur terre, qui ont perdu enfants et maris mais réussi à déjouer « le plan des généraux » comme nulle armée ne l’aurait fait…
Et si aujourd’hui personne ne sait ce qu’adviendra du cessez-le-feu à Gaza, nul n’ignore ce qui est advenu des quinze mois de feu et de sang qui l’ont précédé. L’onde planétaire du choc des images s’est vite muée en empreinte indélébile de la souffrance. Au-delà de documenter les cours de justice, cette empreinte crée un lien brut de douleur universelle dans un éveil brusque d’humanité.