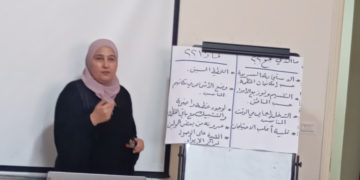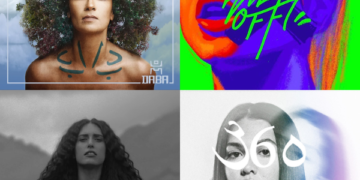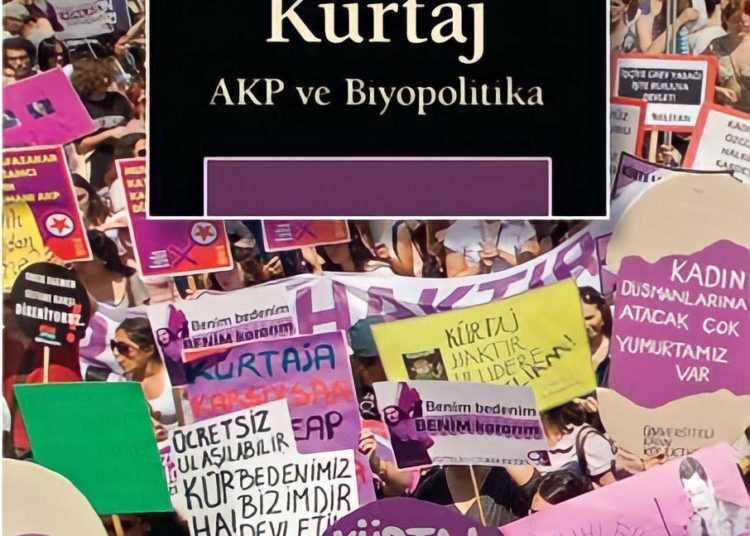20 mars 2025. Le café de l'ancien marché du village d'Erriadh, à Djerba, (ou Hara Sghira) affiche portes closes en cette mi-journée du mois de ramadan. Des voix féminines s'échappent de l’intérieur de l'enceinte. Une dizaine de membres, de 50 à 70 ans, de l'Association d'aide aux personnes âgées, sont venues spécialement au local d'Erriadh pour nous rencontrer et se plonger dans leurs souvenirs de jeu. Il leur arrive de jouer au sig de temps en temps lorsqu'elles se rassemblent entre ces murs, car à quelques exceptions près, le sig a disparu de leurs réunions familiales. « Avant nous n'avions aucun moyen de divertissement. Pas de télévision. Maintenant tout le monde est occupé avec son téléphone, regrette Naïma.
« Nous passons moins de temps à l’extérieur. Chacun est chez soi », ajoute une autre, en faisant mine de fermer une porte. Le sig n'est pas seulement un moment récréatif. Il donne l'occasion de se retrouver, de discuter de tout et de rien entre deux cases. « On buvait le thé ou le café », se remémore Salma.
Le mois du jeûne sacré ou la fête de Achoura étaient des occasions propices au jeu. À Djerba, pour célébrer la seconde, les habitant.es avaient l'habitude de se retrouver en famille. Selon les croyances locales, il était déconseillé d'entreprendre le moindre labeur ce jour-là. Le nombre de participant.es au sig étant illimité et les maisons du menzel (ensemble architectural typique de l'île) ne pouvant accueillir un grand nombre de visiteurs, petit.es et grand.es s'installaient à l'ombre des palmiers ou bien sur l'aire de battage. Les joueuses regardaient ce que la nature mettait à leur disposition, dessinaient un damier dans le sable et entamaient une partie.
Une start-up est née
Le jeu du sig renvoie également Farah Ben Terdayet à des temps anciens. Celui de l'enfance, lorsque âgée d'une dizaine d'années, elle jouait avec sa cousine et sa grand-mère, qui les aidait à trouver le matériel nécessaire : du charbon, des cailloux. Malgré son âge avancé, la matriarche n'hésitait pas à se hisser sur la tige d'un palmier pour casser une de ses branches et confectionner quatre bâtonnets, utilisés comme dés. En 2024, la jeune femme de 28 ans devenue designer, a lancé Mida Games. Une start-up qui promeut le patrimoine ludique tunisien, en commercialisant des jeux traditionnels dans une version moderne.
Farah a gravité un moment dans le secteur du tourisme, l'idée lui est précisément venue au cours d'un festival, alors qu'elle cherchait un moyen original de présenter aux touristes Djerba, son île natale. Mais c'est aussi les jeunes tunisien.es qu'elle vise : « Les générations d'aujourd'hui ne connaissent plus ces jeux. L'idée est de les réintroduire sur le marché pour les faire redécouvrir et préserver cet héritage de notre culture amazighe. » Le sig est le premier à voir le jour. Son projet l'a conduite à questionner les habitant.es de plusieurs localités de Djerba, pour retrouver les règles, qui avaient fini par être oubliées dans sa famille. « Tout le monde ne joue pas de la même façon, j'ai cherché les points communs pour élaborer une version qui parle à tous », explique-t-elle.
« Le sig n'est pas seulement un moment récréatif. Il donne l'occasion de se retrouver, de discuter de tout et de rien entre deux cases. »
En Tunisie, le sig n'est présent que dans le sud du pays, principalement dans les zones rurales et oasiennes. On le retrouve sous le même nom, au Maghreb et dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, dans les régions proches du Sahara, sous des formes très différentes. Suite à des enquêtes de terrain menées en 1988 et 2010, Abderrahman Ayoub, un éminent linguiste et spécialiste du patrimoine culturel immatériel tunisien, décédé en 2021, répertoriait les spécificités du sig à Djerba. Il observait que les joueuses étaient en majorité des femmes musulmanes, mariées, de milieux modestes. Des témoignages plus récents montrent qu'il pouvait y avoir une pratique mixte du jeu en famille et que les hommes le connaissent donc également. La dimension religieuse du sig apparaît évidente au regard du but du jeu : emmener son père au pèlerinage à La Mecque. Les joueuses doivent pour ce faire, traverser un damier en lançant tour à tour les bâtonnets de palmiers en l'air. Si deux tombent du côté blanc et deux autres du vert, par exemple, il sera possible d'avancer de cinq cases. Une des participantes joue le rôle de l'ogresse et se déplace en sens inverse pour ralentir leur progression. Avant, il était fréquent que la partie s'éternise plusieurs jours durant.
Un jeu symbolique
« C'est un jeu intergénérationnel, c'est pour cela que nous l'aimons », souligne Najiba, de l'Association d'aide aux personnes âgées. Le chercheur Abderrahman Ayoub remarquait que le sig réunissait plutôt les adultes, notamment en raison de sa symbolique. « Tu as fait le pèlerinage, tu es parti, tu es revenu, tu as ramené sept barils d'huile ! », récite Naïma en portant successivement le bout de ses doigts à ses lèvres puis à son front, la phrase que la gagnante répète une fois arrivée sur la case départ. Dans la culture locale, l'huile d'olive renvoie à une chose précieuse et inestimable.

À défaut de pouvoir accompagner réellement ou aider matériellement leur géniteur à effectuer le voyage jusqu'en terre sainte, à une époque où il n'était pas aussi facile de s'y rendre, les femmes pouvaient le faire grâce au sig. Il n'y a pas de stratégie particulière, la victoire dépend du hasard, soit la volonté de Dieu, comme dans la vraie vie, selon une perspective religieuse. L'ogresse, principale obstacle, représente les difficultés de l'existence. Dans son étude Ayoub va encore plus loin et affirme que « le damier serait l'image matérielle de la structure invisible qui gouvernerait le cosmos » en impliquant le chiffre cinq et sept. Il développe son propos : « Le chiffre cinq, que l'on prononce souvent contre le mauvais œil, va se trouver à la base de la construction du damier. […] Et suggère les cinq piliers de la croyances islamiques. ». Quant au sept, il correspond au multiple du nombre de cases, 49. « Les joueuses croyantes n'oublieraient pas que les lectures du Coran sont au nombre de sept, les jours de la semaine, les sens allégoriques du texte saint, ainsi que les Cieux et les sept planètes », argumente le chercheur.
Najiba évoque un sentiment de fierté ressenti grâce au jeu : « D'ailleurs si je gagnais j'allais voir physiquement mon père et je lui disais, "je t'ai emmené au hajj (pèlerinage) papa !" Et il était content. » Dorénavant, c'est avec la version de Farah que les membres de l'association jouent. La designer a d'ailleurs vendu plusieurs coffrets à des personnes qui souhaitaient l'offrir à leurs grand-mères. Avec Mida Games, la transmission du jeu pourra ainsi s’opérer d'une autre manière.